AU « VERBE INSATIABLE »
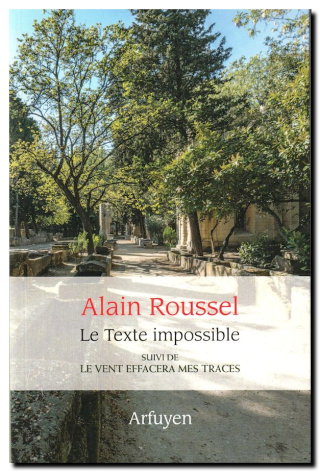 Récit d’une absence, d’un manque, d’une difficulté à écrire l’indicible : la présence de la femme aimée (femme attendue, recherchée, femme inconnue, entrevue, étreinte, imaginée) et quête, enquête, requête, pour ajuster les mots à sa ressemblance, ce « livre impossible » est une recherche éperdue, le lieu d’une épreuve du temps de l’écrire. L’emprise réciproque des mots et des regards entraîne le lecteur dans un tourbillon de rencontres, d’objets et de lieux, qui ne peuvent jamais coïncider ni se substituer l’un à l’autre. Comment dire alors ce « vent » qui vous pousse à écrire et « efface vos traces » ?
Récit d’une absence, d’un manque, d’une difficulté à écrire l’indicible : la présence de la femme aimée (femme attendue, recherchée, femme inconnue, entrevue, étreinte, imaginée) et quête, enquête, requête, pour ajuster les mots à sa ressemblance, ce « livre impossible » est une recherche éperdue, le lieu d’une épreuve du temps de l’écrire. L’emprise réciproque des mots et des regards entraîne le lecteur dans un tourbillon de rencontres, d’objets et de lieux, qui ne peuvent jamais coïncider ni se substituer l’un à l’autre. Comment dire alors ce « vent » qui vous pousse à écrire et « efface vos traces » ?
Dans LE TEXTE IMPOSSIBLE, le poète ruse avec le temps et tente le tout pour le tout : reprendre le fil de l’amour pour tisser un texte (ou un suaire comme Pénélope ?) avec l’amour de celle qui n’est plus qu’amour perdu ; en réalité, il tisse et détisse les phrases à chaque page, retourne son ouvrage, le cisèle sur l’envers, l’endroit, à l’oblique, lui rapporte des pièces étrangères (les poèmes d’avant et d’après), mêle les temps, reprend son fil, tresse le réel et l’imaginaire, puis découd certains espaces, de sorte que l’ouvrage n’avance guère pour réaliser son œuvre — mais devient LE TEXTE IMPOSSIBLE, un tissu dont la fin sort du temps, à force d’ajustements, ̶ revient « à partir » du monde, finalement.
Écrire est paradoxal, c’est s’affronter à l’impossibilité d’écrire avec ce peu qui contient l’essentiel. Dans ce recueil, l’abondance des mots qui se donnent, se livrent, se délivrent, est à la fois un trop-plein et une générosité. Écrire pour Alain Roussel est ici un défi. L’auteur tourne autour de ce qu’il cherche à dire, qu’il ignore en partie ; il l’ausculte en tous sens, en secoue la trame mouvante, en recoud le tissu malmené, usagé, troué par endroits. Écrire est une tentation et une tentative pour donner forme et vie à ce qui n’a plus d’objet ni de sujet véritable.
En préambule, Alain Roussel nous donne à lire une « Lettre-poème pour un amour perdu ». Les mots s’inscrivent dans l’orbe des regards, s’arrêtent aux détails observés, une jambe, un sac de femme — ce sac prend une importance singulière, peut-être symbolique, nous le VOYONS. Les mots sont le sac lui-même et peuvent s’ouvrir à leur tour, donner à voir, libérer les questions les plus intimes sur son « contenu ». La sexualité n’est réelle qu’à notre insu, cachée là.
L’auteur s’est embarqué dans le flux des mots, le lecteur aussi (livre lu avec grand plaisir et d’une seule traite). Nous sommes littéralement embarqués et le livre, cette étrange chaloupe, se débat avec ses propres vagues et récifs, risque de se retourner, risque le naufrage dans « la mer immense de l’écriture ». Écrire cet aveu même de l’écriture « la pauvreté immense de l’expression devant l’incommensurable » (p 71), qui se regarde écrire ̶ et si l’écriture semble succomber parfois au poids de la profusion, elle sait aussi se rediriger vers le monde visible pour y reprendre appui (Les Baux-de-Provence, l’abbaye de Montmajour, les Alyscans à Arles, donnent la palette lumineuse du livre).
Avec Rimbaud : « écrire des silences — noter l’inexprimable. »
ou avec Wittgenstein : « Le seul arrière-plan du langage, c’est l’indicible ».
Les mots sont démunis pour dire le visible, et le désir. Ils ne se connaissent pas. Ils ne touchent pas leur cible. Toujours se tient cet écart plus ou moins vaste entre le mot et la chose (on pense à Roger Munier qui l’a si bien montré). Cet écart est le moteur même de l’écriture. Le réel est inatteignable et pourtant l’enjeu, le défi des mots, est de rivaliser avec le regard, avec le vécu (comme l’écrit avec la peinture) — de faire des mots le support même du regard sur le monde. Les mots ne sont pas fatalement frontière, écran, ils sont, comme la peau, le point de contact avec le monde.
Le poète ne décrit pas la beauté lumineuse des lieux, il la suggère, car toute contemplation a besoin de silence. L’écriture porte en elle ce suspens, cette lumière. Les mots bruissent en regardant ce qu’ils écrivent. Ils se souviennent et rapportent inlassablement d’autres mots sur la grève de la page. La marée des mots n’est pas un ressassement, mais une vraie quête pour dire le même autrement. On pense à la musique répétitive de Steve Reich qui opère de légers déplacements pour nourrir le temps de l’écoute en ses plus infimes élans (décalages, superpositions, ajout de motifs, travail de la structure temporelle) ̶ « Seul le chemin sait où il va ».
Les traces écrites seraient des ombres et nos ombres des mots perdus, des rencontres qui n’auront lieu que sur la page et qui tournent autour des sépultures de mots, ces corps insaisissables qui se coulent dans le moule du livre, sous l’éclairage singulier du chemin des Alyscamps (photo de couverture), où se rejoignent l’amour et la mort.
L’amour des mots succède à l’amour des corps et laisse des traces qui ne peuvent rendre compte du réel, seulement de sa traversée. C’est là tout l’intérêt du livre d’Alain Roussel, le foisonnement de la traversée, son aspect intemporel malgré la précision des dates liées à des événements repérables de la biographie de l’auteur. Dire la magnificence des lieux, entrer dans les flux et reflux du désir charnel, ̶ l’écriture n’est-elle pas le désir même ?
Toute présence humaine s’échappe du livre et l’écriture ne cesse de douter de ses propres capacités à saisir, à se canaliser. Elle consent à ses débordements, au labyrinthe de ses sursauts, aux noces secrètes des mots et des choses. Elle s’accepte, ne renie pas ses passions, ses outrances, ses illusions.
*
Le poème inaugural n’a pas inspiré LE TEXTE IMPOSSIBLE. La liaison avec la femme aimée dura quelques années et a inspiré ce poème tandis que LE TEXTE IMPOSSIBLE provient d’une période antérieure vécue avec une femme souffrante, souvent mutique, pour laquelle il était vital de réinventer l’histoire amoureuse, à l’intersection des corps et des lieux, de les brasser, les tisser en un ensemble qui nous émeut parce qu’il nous renvoie à nos propres excès, à nos années de jeunesse où tout semblait possible et s’incarnait.
Écrit sur stencil en 1975, publié de façon confidentielle en 1980, l’auteur de ce TEXTE IMPOSSIBLE a eu l’excellente idée de le remettre au jour, le remaniant légèrement et l’encadrant de très beaux poèmes autobiographiques, qu’il serait difficile ici d’évoquer sans les trahir, tant ils forment un chant fragile et tendre, comme « un dernier feu d’amour » dont la mélancolie contient l’« indice peut-être d’une nouvelle naissance. »
Écrire ce qui vous a propulsé dans l’écriture comme dans l’amour, à partir de ce « tumulte intérieur » qui va vers le texte comme vers l’étendue de la mer, « vague verbale où je me noie », dans l’immensité de son ouverture, sans chercher le peu, le condensé, mais au contraire en accueillant ce qui se dilate, s’exalte, s’élargit, se développe sans fin. Ce n’est pas écrire pour remplir, mais pour se délester, revenir au plus que réel : « cette femme… j’ai tissé autour d’elle une parure qui ajoutait à sa beauté l’éclat du verbe ». Cette noyade-là est désirée, égarement et jouissance, plaisir pris à l’impossible saisie, lieu d’une vie possible une fois mis en mots. Se rappeler Pierre Jean Jouve : « La poésie est établie sur le mot, sur la tension organisée entre les mots, c’est le “chant” […] sur le pouvoir occulte du mot de créer la chose. » (dans En miroir)
Le TEXTE IMPOSSIBLE est un livre témoin d’une époque qui ne craignait pas de s’exposer, d’interroger ses contradictions, d’étudier l’origine de chaque mot, pour « trancher les repères » (poème p 87), rejouer au présent la force d’incertitude qui nourrissait les échanges et les rencontres, comme par exemple, avec celles avec Petr Kral, Alfred Jarry, Samuel Beckett, André Breton, Arthur Rimbaud… La poésie pouvait traverser l’obscurité, jouer de ses « rudiments de voyance » (Rimbaud). Aujourd’hui « la société est un système cannibale qui dévore nos gestes, nos paroles et nos pensées […] sans cesser de vouloir tout contrôler. » (p 59)
Dans ce livre puissant d’où jaillissent des pages d’errances dans l’étalage de leur sujet, nous ne sommes pas dans une impasse de l’écriture, mais au plus vif du lieu où se perdre est aussi se trouver, se retrouver, se reconnaître, survivre. C’est un cycle qui ne se ferme pas. Le mot FIN tient lui aussi de l’impossible puisque le temps ne s’accomplit pas sans disparition, sans effacement du temps — le livre est pour un temps ce lieu peu sûr de lui-même qui prend son origine dans le désir, dans l’absence qui sans fin renaît pour se perdre à nouveau dans le silence.
Ainsi le dernier poème du livre ouvre-t-il sur une fin d’été où, nous raconte l’auteur, « les plus belles flaques de lumière/je les trouvais dans les yeux des passantes » et où, ayant « déjà fait naufrage / j’appris à me rendre invisible ».
*
Sortir un texte ancien de sa clandestinité, après quarante-huit années, c’est y croire assez pour assumer la responsabilité de le donner au monde. C’est un bouleversement intérieur qui s’expose, une insatisfaction existentielle et en même temps la jouissance d’un engagement dans l’écriture, presque jusqu’à l’égarement — une façon de rendre justice au temps, de parler le silence, de sauvegarder le « principe de plaisir ». Forer l’infirmité du mot, combattre les « faux en écriture » (p 34), et « nos incapacités de dire comme de taire ».
Un livre très dense en détails, dont des extraits de lettres, « cherchant dans ces indices la trace d’un texte qui se dérobe continuellement » (p 40) ;
« C’est ça l’écriture, ça part d’un point […], d’un O […] qui m’absorbe dans le tourbillon d’un dire sans issue […], une danse de derviche. »
Merci, Alain Roussel, de nous entraîner dans les profondeurs de ce tourbillon.
Bibliographie partielle
Internet
Contribution de Marie Alloy