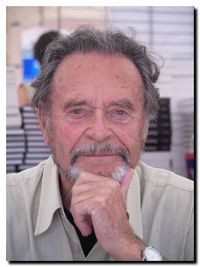 Jean Joubert est un homme
discret et sans histoire, au moins en ce qui concerne son histoire
personnelle, car il est aussi une homme à histoires, celles qu’il
raconte dans ses romans.
Jean Joubert est un homme
discret et sans histoire, au moins en ce qui concerne son histoire
personnelle, car il est aussi une homme à histoires, celles qu’il
raconte dans ses romans.
Il est né en 1928 dans le Gâtinais, aux environs de Montargis, dans une famille modeste, où raconte-t-il, « Je considère avoir eu une enfance heureuse. Ce qui est une vision paradoxale car j’ai connu la guerre à la fin de mon enfance. J’ai grandi dans un monde à la fois rural et urbain . A Châlette, il y avait encore des troupeaux, et de l’autre côté de la rivière une zone industrielle, avec des usines comme Saint Gobain et d’autres. » in Jean Joubert libre enfance, article de Jean-Marie Dinh
Il a gardé un souvenir formateur de son oncle Georges, sabotier de son état, anarchiste ancré à gauche et qui lui a donné le goût de la littérature. « J’ai reçu, raconte-t-il, de son héritage, les œuvres complètes de Zola que j’ai conservées. C’était un homme très convaincu qui avait toujours un livre dans les mains quand ce n’était pas un sabot. Il était marié à une institutrice qui refusait de faire chanter la Marseillaise à ses élèves. Toute ma famille se tenait loin de l’église. Un jour, le curé du village a dit : Les Joubert c’est une famille perdue. Cette formule m’est restée. » ibid J.M. Dinh
Ses études de lettres terminées, il opte pour la littérature anglo-américaine, qu’il enseignera pendant plusieurs années à l’université Paul Valéry de Montpellier et, parallèlement entre personnellement en littérature avec une production romanesque et poétique devenue imposante au fil du temps et regroupant aujourd’hui une centaine d’ouvrages
A travers eux, court en filigrane ce va et vient constant entre ses deux rives, celle de son enfance rurale et ouvrière et celle de sa maturité universitaire, ambivalence qui donne à sa poésie cette dualité constante entre l’ombre et la lumière, le plein et le vide, le paysage bucolique et l’enfer des villes de fer et d’acier.
Dans son dernier recueil Etat d’urgence, qui regroupe ses poèmes écrits entre 1996 et 2008, dans une première partie intitulée Fin de siècle, il aborde poétiquement les transformations que la modernité et ses nécessités ont fait subir aux pratiques agricoles ancestrales. Aux puissantes odeurs animales d’autrefois leur succèdent aujourd’hui celles du fuel et des produits chimiques. Et à ces souvenirs vécus, vient se greffer son sens du merveilleux : « Iris blancs, iris noirs / mêlés / colombes et loups mêlés »
Et comme le souligne Claude Vercey dans sa critique de ce recueil, sous le titre Instants de grâce, publié dans le numéro 143 de la revue Décharge en septembre 2009 : « En fait, même hors toute référence à un tableau, Jean Joubert cherche à peindre, en une composition fermement dessinée, bien que se tenant à la frontière entre rêve et réalité, proche d'un romantisme nocturne et onirique, héritier de Nerval mais aussi, par son amour des contrastes sur fond noir, entre feu et glace comme entre proche et lointain, de Victor Hugo. Le paradoxe, aujourd'hui où il semble s'imposer au poète d'écrire d'abord contre la poésie, est la fidélité de Jean Joubert envers un art de tradition, poétique comme picturale : il se singularise ainsi, à contre-courant de ce qui gonfle les bataillons de prétendants à la contemporanéité, en se faisant le gardien de charmes anciens. (…) »
Le siècle meurt
II
y eut le vol bas de l'épouvante
le tremblement de la terre et du
ciel
Dans l'ombre des couteaux
l'homme quêtait l'arche
d'une embellie
(Terreur
sur les confins
charmer à la lisière de la nuit
les fleurs
de sang la main coupée)
II y aura toujours
ce pan de suie
et de douleur
incurable blessure
Et de l'espoir
jadis d'un jardin immortel
où fleurirait la nudité du corps et
de l'esprit
il ne reste que cendre
sang pus sanie
crasse
rouille et gangrène
silence noir après l'embrasement
Le
siècle meurt
un vent mauvais disloque l'héritage
in Etat d’urgence, Fin de siècle © Editinter, 2008, p. 9
****
Printemps
noir.
Des couteaux dans chaque fleur,
sous chaque pierre un
assassin.
Partout viols, meurtres, rapines,
complicités et
grimaces.
Le mensonge en étendard,
l'évangile du
saccage.
Que deviens-tu, terre de sacre,
par tant de
griffes déchirée,
sanglante à la saison des sèves ?
Et
de l'enfance, la bien aimée,
l'innocente, la lointaine,
que
reste-t-il sinon un songe,
une
buée d'amour sur les miroirs.
Ibid p. 13
****
Quand
la ville écarte et secoue son manteau de nuit
l'aube
s'emplit d'une clameur :
sifflets,
sirènes, sanglots,
un rire, un cri, parfois une plainte,
mais
aussi, plus profonde,
la
basse rumeur d'un
fleuve invisible :
fleuve innommé, sans rive ni regard,
qui
gronde obscurément dans une gorge
comme de géante engloutie.
La bouche souffle une parole indéchiffrable,
Celui
qui descend l'escalier de brume vers le fleuve
s'est armé d'une
faux.
Il dit qu'il ne sait ni le signe ni la route,
qu'il est
traqué,
qu'il se confie à la bienveillance d'une étoile
ibid p. 14
****
Dans
le jour, suspendue,
la main du peintre hésite,
hasarde une
embellie,
suscite enfin sur la lisière du désastre
l'arbre
fendu,
la femme échevelée de feuilles et d'oiseaux :
sorcière
nue, témoin et sentinelle.
Dans le creuset de sève
agile,:
l'écart
des branches,
entre nuit et clarté .
germe
le sang futur.
Ibid p. 24
****
Signe de vie
Asseyez-vous,
peuples de loups, sur les frontières
et négociez la paix des
roses, des ruisseaux,
l'aurore partagée.
Que les larmes, les
armes
s'égarent dans la rouille et la poussière.
Que la
haine crachée soit bue par le soleil.
La terre ouvre sa robe de
ténèbres,
sa nudité enchante les oiseaux,
le jour se fend
comme fille amoureuse.
Sous un ciel ébloui
viennent alors
après tant de saccage
les épousailles de la terre et du feu,
le
temps des sources,
des naissances.
Après le sang, la
traîtrise et le cri,
ah, tant rêvé le règne des moissons
pour
le bonheur des granges.
À nous qui hébergeons l'aube de la
parole
de rassembler le grain,
les mots de l'espérance.
Un
jour d'été, l'enfant plonge dans la rivière,
joue avec le
soleil
sous le regard apaisé d'une mère,
le héron danse sur
son nid de sable,
le renard ouvre des ailes d'ange
et le
serpent, le mal aimé, forçat de la poussière,
sauvé,
s'étire entre les seins du jour.
Ibid p. 32
****
Parfois,
la nuit, dans les villages,
les chiens s'éveillent,
aboient
plaintivement
comme des âmes arrachées à la lumière.
Et
les dormeurs, au creux de leur sommeil,
gémissent, se
retournent,
étreignent leur fatigue,
tandis qu'au loin,
par les hameaux,
la plainte se prolonge.
Minuit masque la
lune.
Personne n'aura vu dans les ruelles
l'ombre géante,
sans visage,
glisser de seuil en seuil à pas de
loup.
Personne
sauf un
chien noir ,
blotti près de l'église
et
dont l’échine maigre se hérisse.
Ibid p. 39
****
Parfois
surgit l'âpre désir
de desserrer les doigts, d'ouvrir
la
main qui nous retient à l'arbre de lumière,
de lâcher
prise.
Parfois dans l'âme prisonnière
monte l'appel des
gouffres
et le très bas murmure
des voix défuntes dans la
brume.
Ce qui soudain occulte le soleil
est une main
géante,
l'ombre d'une ombre
et d'un corps invisible.
On
tomberait alors sans plus d'espoir d'une aile
vers des pays
profonds,
des rives de silence
où des spectres aimés
tissent
des gestes éternels.
Et là, le feu s'étant renié, on
glisserait
dans la tendresse obscure de la terre.
Pourtant
ce qui nous tient
est une main d'enfant,
un livre
ouvert,
l'aurore
d'une voix.
Ibid p. 48
****
L'écolière
qui va par des sentiers de brume,
frôlant
la rose, la fougère, la tourterelle,
ne
nous reviendra-t-elle, un soir,
le
cœur fermé, la bouche ravageuse ?
Alors
il n'y aura ni rose ni fougère
ni
tourterelle
mais
un visage dur où l'enfance sera
comme
un reflet lointain du
ciel au fond d'un puits.
Ibid p. 58
****
Silence
dans la graine
silence et nuit
Au plus noir de la
graine
une fille endormie
laissée d'amour sur lit de
sève
Silence et nuit dans la graine
Silence et nuit dans
le corps immobile
Espace et temps niés
Mais le printemps
d'amour
soudain s'éveille
marche sur l'eau
Le sauveur
est en marche
il écarte les branches
La nuit se fend
remue
On
y chante l'arbre et l'enfant
Ibid p. 62
Dans la seconde partie intitulée Arche de la parole, et reprise d’un recueil de même titre publié en 2001, le poète reprend les thèmes plus lumineux qui lui sont chers, et qui, pour la plupart, s’articulent autour de ses souvenirs sublimés d’enfance, rappelant une époque où le travail de la campagne avait son poids de sueur, les animaux un statut d’être vivant, et où les petits bonheurs au jour le jour étaient dérisoires mais précieux.
La dormeuse
Puisqu'elle
dort,
dans la forêt de ses cheveux
nous démêlons feuilles
et lianes,
ailes et griffes, fruit et poison,
nous démêlons
les lourdes mèches de la mort.
Dans la forêt,
passent le
cerf, le renard et la biche
et passe le veneur,
le brutal vêtu
d'orgueil,
ganté de sang.
Nous
démêlons, nous démêlons
les mèches dans la
douleur.
Et la dormeuse, l'errante,
poursuit un rêve de
sang.
Est-ce le cerf qui brame au loin
ou bien le cor :
la voix de l'ogre ?
in Etat d’urgence, Arche de la parole © Editinter, 2008 p. 83
****
La maison vide
La
maison vide, décharnée.
Pourtant, à la fenêtre,
brûle une
maigre lampe
comme à l'époque du
pétrole ou des
chandelles.
Rien ne bouge, on croirait
que pour toujours la
scène s'est figée.
En quel temps sommes-nous? Quelle saison?
Et
celle qui lisait près de la lampe,
l'absente, où marche-t-elle,
suspendue,
ne sachant plus ni le jour ni la nuit ;
tandis
que veille encore à la croisée
la flamme qui se glace.
Ah!
mère, sur quel livre, sur quelle page,
ta main de morte, le
dernier soir,
s'est-elle
posée ?
ibid p. 94
****
Temps de chien
Le
ciel aboie au flanc de la colline,
griffe l'octobre des labours,
crache au vent les feuilles mordues.
La délaissée lève
une lampe,
dans la terreur écoute l'ogre
qui dehors rôde et
souffle dans le noir.
Le feu n'est plus qu'un œil sous la
cendre.
Sur le lit défait
gît la peau sanglante d'une bête.
Ibid p. 112
****
Lavandières
Toute
la nuit dans le pré
les sombres lavandières
battent et
tordent les enfants morts :
pauvres bâtards perdus,
minces
larves pour les limbes
jusqu'à ce que le cri du coq,
le
couteau de lumière,
tranche et arrache
les linges
ténébreux.
Alors se fend la nuit
et c'est
naissance dans le sang:
soleil
et
triomphante gloire.
Ibid p. 113
L’avant-dernière partie intitulée Partage du soir regroupe une vingtaine de poèmes où dominent la nostalgie de ce qui fut et ne reviendra plus, les ombres de ceux qui furent aimés et continuent de vivre seulement dans le souvenir du poète.
Belles
mortes qui voyagez
par les chemins profonds,
parlez-nous,
dites-nous ce qui là-haut demeure :
mémoire ? amour ?
lumière ?
Tendez vers nous vos mains de laine,
tressez
sur nos visages
les voix menues de l'invisible.
in Etat d’urgence, Partage du soir © Editinter, 2008 p. 129
****
Lorsque
je vis pour la première fois
cette femme
assurément très
belle
et qu'elle me regarda
comme savent le faire certaines
femmes,
nues déjà dans leur regard
entre les cils,
il me
sembla voir ma mort,
non pas avec la crainte coutumière
des
ténèbres et du néant
mais comme une ardeur soudaine,
un
embrasement
d'arbre saisi de feu,
poussant très haut
sa
torche éblouissante,
pour retomber en cendres
sur la terre :
(ayant brûlé très haut,
n'ayant vite laissé que son
empreinte noire)
ibid p. 139
****
Deux
femmes face à face,
l'une à genoux, -
les yeux tendus vers
l'autre,
debout, un peu penchée,
se regardant
et de
semblable noir vêtues
et de semblable amour percées
l'une
lumière,
l'autre terre,
percées
d'un
rai
bleu,
d'une douce lance.
Ibid p. 143
****
Quelques
visages demeurent
comme reflets sur l'eau
de ceux qui vers
nous jadis
se penchèrent,
pour nous parler, pour chercher
dans nos yeux
un accord, une promesse
- si clairs, si
nets
que l'on s'étonne
de ce ciel vide entre les arbres
et,
sur le pont,
de la seule poussière.
D'autres encore
tremblent par temps de brume,
se brouillent, se
disloquent,
insaisissables presque :
ombres d'ombres pour nos
regards.
Et
tant d'autres nous abandonnent,
mêlés, sans nom, au plus noir de
la terre.
Pour eux nous n'avons plus ni lampe ni mémoire.
Ibid p. 149
****
Les
ronces, on les brûle
dans les matins d'hiver
quand l'air est
creux
de gel et de silence.
Parfois
la main s'irrite
d'une mince griffure
où le sang brille
que
l'on lèche.
Mais
la dent qui nous blesse,
par le feu consumée,
ne laisse au
vent
qu'une pincée de cendre.
Ibid p. 152
****
Paroles,
paroles dans le noir :
proies futures du pêcheur
d'ombres.
J'ai tiré le filet,
la maille s'est
rompue.
L'eau gronde et grouille de merveilles
se replie dans
ses gouffres.
Ah ! désert du jour,
famine du corps et du
cœur,
et la main vide où pourtant luit
l’œil
du vent.
Ibid
p. 153
Jean
Joubert, aujourd’hui bien enraciné au soleil du sud, continue de
creuser paisiblement son sillon de poète et de romancier, et comme
l’indique son amie Annie Estève, : « C’est quelqu’un
de très simple. Il a une profonde nostalgie de l’enfance que l’on
retrouve dans sa façon d’être.
Dans cette capacité de pouvoir
espérer, de jouer, de regarder. Il aime transmettre à la jeunesse
et il le fait avec une extrême bienveillance. C’est un homme
lumineux et aussi très secret. Il ne fait pas partager ses chagrins,
ses soucis. Cela, il préfère le taire. »
ibid
J.M. Dinh
Il a obtenu, en 1975, le prix Renaudot pour son roman L’homme de sable, et en 1978, le prix de l’Académie Mallarmé pour ses poèmes édités chez Grasset.
Bibliographie sélective
-
Les Lignes de la Main, © Seghers (Prix Artaud 1956)
-
Les Poèmes - 1955-1975, ©, Grasset, 1977 (Prix de l’Académie Mallarmé)
-
La Main de feu, © Grasset, 1993, (adolescents)
-
Anthologie personnelle, © Actes Sud, 1997, (adolescents)
-
Arche de la parole, © Le Cherche-Midi, 2001
-
État d'urgence : Poèmes 1996-2008, © Editinter, 2008
Internet
-
entretien video de Nourdine Bara avec Jean Joubert qui raconte ses souvenirs.
-
un article d’Emmanuel Hiriart, de la revue Poésie Première.
-
Jean Joubert ou les deux versants du poète, un article de Jean-Paul Giraux.
Contribution de Jean Gédéon
Commentaires