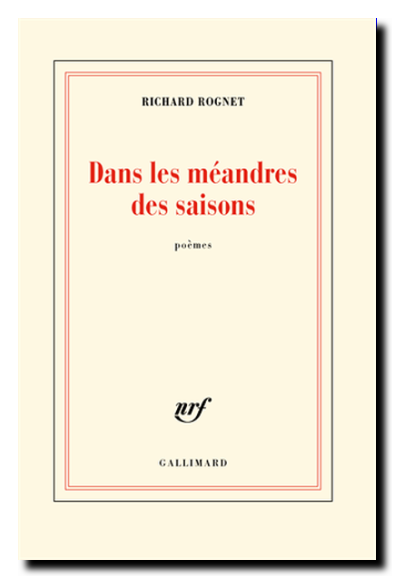 Le nouveau recueil de Richard Rognet est constitué de deux livres étroitement reliés par un poème charnière, selon une construction très travaillée. Deux livres, de respectivement 60 et 33 poèmes, Richard Rognet étant attaché au chiffre 3 – sa mère est morte le 9 octobre 2010, ses parents se marièrent le 3 avril 1939, les 33 variations Diabelli de Beethoven ont présidé à la gestation du recueil… Les poèmes sont construits sur la forme du sonnet, chaque vers bâti sur le modèle d’un alexandrin librement coupé :
Le nouveau recueil de Richard Rognet est constitué de deux livres étroitement reliés par un poème charnière, selon une construction très travaillée. Deux livres, de respectivement 60 et 33 poèmes, Richard Rognet étant attaché au chiffre 3 – sa mère est morte le 9 octobre 2010, ses parents se marièrent le 3 avril 1939, les 33 variations Diabelli de Beethoven ont présidé à la gestation du recueil… Les poèmes sont construits sur la forme du sonnet, chaque vers bâti sur le modèle d’un alexandrin librement coupé :
« Que de cris sans écho sous les bruits de / la vie ! ».
Le recours à l’anaphore est quasi constant, le poème tirant son unité de la reprise, par trois jusqu’à sept fois, d’un mot, d’une expression, voire d’un vers. De façon générale, la musique – « les / brises où les fleurs ont fixé leur parfum » – contribue à une forte impression de lyrisme élégiaque, que ne desservent pas, loin s’en faut, l’emploi d’expressions familières – « en avoir gros sur le cœur, vivre à la dure, s’en donner à cœur joie… » – et un ton, qui s’impose au lecteur comme celui de la conversation courante – « Elle va durer, la pluie ».
On retrouve en toile de fond une amertume caractérisée, un désenchantement, qu’il soit celui du poète ou de la saison : au « départ », – celui qui « ouvrit une brèche /en ton cœur » – se sont ajoutées les nombreuses disparitions d’êtres chers ; aussi existe-t-il « d’énormes fondrières » dans « notre vie / que le temps accable peu à peu », « lourde » et limitée par une « ténébreuse frontière qui [l’] emprisonne ».
Réapparaît aussi le thème de la dispersion du moi, de son émiettement : « Comment te délivrer du temps mort sous le temps ? », d’un passé qui se solde par une catastrophe, réduisant le poète aux « lettres / dérangées d’un alphabet meurtri qui s’effondre » ; il est significatif que, comme dans ses précédents recueils, Richard Rognet conjugue, pour se parler à lui-même, l’usage du tutoiement au pronom de la première personne.
L’enjeu de la poésie va donc être de repousser ce qui oppresse, d’alléger, d’apaiser et de permettre à la vie de triompher. La vie, maître mot du recueil : il s’agit de « pouvoir reconnaître, parmi [s]es phrases, les frôlements infinis du monde » et d’en célébrer « la gloire », de « tenter des paroles aussi vivantes » que ses rêves, afin de résister aux tristesses. « Allez ! soyez la vie, mes mots, rien qu’elle », ces mots qui, allant « à l’assaut du monde » pour en conter jusqu’aux plus humbles péripéties, sont le seul moyen de délivrer un « passé mort que [comme Pessoa, cité en exergue, Richard Rognet] porte en [lui], et qui n’a jamais existé en dehors de [lui] », et par là-même d’accéder à « l’infini qui [l’]obsède ».
Encore faut-il d’abord identifier les ennemis redoutés : le passé dont les « griffes » nous « arrachent» à la plénitude du présent. Mais aussi, malgré sa trompeuse apparence de paix et de douceur, « la nuit guerrière », qui abrite aussi la présence de l’ennemi et annonce « le désastre ». Plane en effet, diffuse mais réelle, une menace du « destin » qu’« on voudrait désarmer » par une réconfortante tendresse : la mort est « cette espèce de / mystère qui n’en finit pas de nous foudroyer », si épais qu’on s’épuise en vain à « chercher » un salut ; elle est ce spectre omniprésent qui empoisonne nos vies et empêche de libérer la douceur qu’elles recèlent, comme en témoigne, par exemple, l’impossibilité de serrer dans ses bras sa vieille mère. L’être cher n’est plus qu’« un tout petit reflet que / le brouillard […] avale sans le voir », vite « pouss[é] dans le noir ». Devant la réalité de la mort, quelle cruelle acuité prennent les souvenirs de l’amour perdu ! Toute séparation antérieure, fût-elle due à une brouille, en voit relativisée sa gravité.
A travers ces douleurs se dessine malgré tout ce que Richard Rognet appelle « la forme de l’espérance ».
Car la vie ne cesse d’être présente, infiniment aimable et aimée. Aussi constitue-t-elle le remède ultime, sorte de phénix sans cesse renaissant de ses cendres :
Le soleil, humble encore, apporte un peu de vie
au jour que l’hiver enferme dans le gel…
Ce sceau indélébile de mélancolie qu’a laissé sur notre existence un premier départ, la vie sait au moins le faire « oublier quelquefois, en douceur », une douceur qui, rimant avec bonheur, en tient lieu. « Avec ses petits riens », certes, mais aussi par sa force élémentaire : « la vie qui monte du sol s’empare de / la mienne et se retire en moi ». La quête d’une sagesse se fait jour, qui consiste pour chacun à s’insérer dans le tout de la vie, à y prendre toute la place qui est la sienne, aussi bien dans le temps que dans l’espace : « Ta vie est un éclat de la vie de toujours, et ce / toujours, en toi, se déploie comme une aile ». La sagesse, c’est chercher un rapport au monde « juste » : dans « les jours désaccordés », Richard Rognet s’emploie, avec espoir et prudence, à trouver le lieu comme les moments où « le monde devient lisible », ceux où « la vie a les accents de l’amour ». Cette justesse, c’est avant tout dans la nature, omniprésente, qu’il la trouve : « Entre dans l’innocence de la forêt ». Il adopte à son égard une attitude qui n’est pas de domination mais d’accueil et de douceur : « tu ne veux rien / conquérir, il te suffit d’effleurer le tronc / d’un hêtre ». Il s’y trouve ainsi « à la lisière du visible » et le rapport au monde se fait alors communion et révélation : « la / profondeur de la terre dépend de tes pas et / celle du ciel de ton regard ». Richard Rognet décrit les réalités les plus diverses – arbres, fleurs, oiseaux de toutes sortes – et de l’attention passionnée qu’il prête à toutes choses, jusqu’aux plus humbles, naît une compréhension plus profonde de ce qu’elles sont. Ainsi les gestes d’un artisan lui apparaissent « donn[er] sa taille à l’humanité et, / au monde, la force de la beauté».
La sagesse de Richard Rognet consiste aussi à ne pas vouloir forcer les portes du passé, même heureux, et à laisser le présent indemne de tout empiètement. Par rapport au passé consciemment vécu s’impose la prudence : il peut être dangereux de le réveiller ; son souvenir fait mal, à moins que la mémoire ne serve à rappeler des vers ou à transformer ce « nid / qu’auraient construit les souvenirs lointains » en une poésie qui les restituerait à l’intensité du présent. Mais de façon générale, « l’oubli salutaire » vaut mieux, permettant au regard de saisir l’instant présent et à la vie de « reprend[re] le dessus ». Plutôt que de nous égarer dans le souvenir, privilégions le présent et ses exigences concrètes, positives : « Mais pour l’heure, chez / toi, prends soin des rosiers qui t’éclairent ».
La marche est un autre accès à la sagesse, elle est garante de méditation : « Ce qui / manque à ma vie, je l’oublie en marchant », dit l’infatigable promeneur. Pour ne pas rester « en retrait de la vie », il faut encore, outre la solitude, nécessaire et bénéfique, « trouver la place du silence », qui « seul, à l’infini, t’aide à t’approcher / de tout ce qui est né dans l’épaisseur du temps », au premier chef la nature. Le silence et la solitude, sa compagne, lui apprennent à voir le monde dans sa réalité propre et ce faisant, à pénétrer au cœur de la vie : en attendant par exemple, à l’abri des sapins, « que la vie qui monte du sol s’empare de / la mienne et se retire en moi ».
Le poète trouve ainsi dans les pierres une présence tutélaire et une sympathie source de joie profonde ; de même, l’arbre embrassé infuse dans son corps un mélange de bonté et de joie, qui est la vie même, une vie « allégée ». Oui, il faut « se tai[re] pour franchir la lumière », cette lumière qui est pour Richard Rognet une réalité essentielle dont il fait si fréquente mention, qu’il s’applique à saisir, en particulier à travers l’action bénéfique du soleil ; la sagesse consiste à « nous contenter [comme les oiseaux] de la clarté ».
L’ultime moyen, devenu objet même de la quête, c’est cet « enfant secret » qu’il s’agit de retrouver en soi, après avoir enfin reconnu que son être propre n’était autre que lui, « seulement » lui…
Ce juste rapport au monde, fait d’empathie et de communion, se manifeste par une correspondance entre monde intérieur et monde extérieur : ainsi une longue marche dans la nature revient à se retirer en soi, la douceur d’un regard « complète » celle de l’air et dans un paysage, le poète retrouve la forme d’un rêve nocturne. C’est précisément la poésie qui permet de réaliser cette correspondance entre intérieur et extérieur, elle permet au poète de supprimer la distance qui existe entre le monde extérieur et son moi profond, inconnu de lui-même, « plein de rumeurs venues de très loin », séparé par un véritable « abîme ». De même la correspondance qui s’établit au cœur des poèmes entre micro- et macrocosme permet à Richard Rognet d’établir entre les différentes réalités du monde des rapports inédits, subtils et pertinents :
« le soleil, mon / étoile, en moi, si lointaine, / si proche, que j’accueille comme / un souvenir qui aurait pris racine / dans le Noir, bien avant moi, et qui / ressemble tant à la chute de quelques / feuilles déjà rousses qui tombent / sur la terre comme un regard intemporel ».
Le juste rapport au monde se trouve ainsi défini par une triple dialectique, qui oppose à la pesanteur, l’emprisonnement et l’obscurité, la légèreté, la liberté et la lumière, autant de notions complémentaires l’une de l’autre. Alors, au contact de la nature « se réapprend la bienveillance » et l’être se dilate à des proportions cosmiques : « j’épouserai le temps et l’âme des étoiles ». Il y a confusion des règnes végétal et animal (« les arbres se grattent »), interpénétration du haut et du bas : « le ciel / naît tout entier dans un bouquet de campanules » ; de même s’unifie le temps, puisque passé et présent, proche et lointain convergent « vers un ailleurs qui te rassure ».
Alors l’autre, – qu’il soit un ancien amour, la mère, une vieille femme, malade ou démente –, cet autre à qui Richard Rognet sait toujours donner sa place et témoigner une compassion profonde, se révèle prendre part à « la forme de l’espérance » recherchée : « n’avoir pas su aimer à temps » est le seul véritable regret et la tendresse, – une tendresse aussi pudique que profonde, toujours étroitement liée à la lumière – constitue le vrai trésor ; l’autre est remède contre le destin et la mort, puisque, dans sa bienveillance, il possède la clef de notre être, et qu’à travers la lumière de son regard, il est possible de « retrouver [s]a route », et parfois même le fantôme des êtres disparus, qui vivent « dans l’inconnu d’autres présences ».
Malgré un « siècle en mal de tout », malgré les regrets et la cruauté de l’amour disparu, malgré l’ombre portée par les « désirs inassouvis », par-delà ses doutes, terribles à certains moments, et les accès de désespoir, s’affirme en définitive la confiance retrouvée du poète des Méandres des saisons : « j’ai décidé de vivre », affirme-t-il. Car « l’amour est un cri qui délivre le ciel », – cet amour en réserve, par « vagues » entières. Le moyen, romantique par excellence, d’assumer ce choix consiste à se plonger dans la nature, consolatrice, dispensatrice de joie et de gloire, gardienne fidèle des souvenirs qui nous ont abandonnés, soustraite à la duperie des apparences et révélatrice de la vérité, fût-elle cruelle ; voici le mot d’ordre : « Sois la forêt, l’oiseau, le ciel ». Sans jamais oublier la puissance des poèmes : « Richard, dis toujours des / poèmes, les mots sont des sources, des clefs », sans doute parce qu’ils sont le fruit de cet « un peu plus d’attention, de / ferveur » qui permet de « soustraire à l’oubli […] nos morts engloutis / dans leur nuit ».
*
Elle était là quand on rentrait
« La mort et la vie sont le même / visage de notre destinée », lit-on dans le premier livre. La mort de la mère est l’événement crucial, redouté entre tous, qui devient ici la matière du poème. Trente-trois poèmes, où la réalité de la mort va être cernée dans sa triple dimension temporelle, suscitant tour à tour la stupeur épouvantée, la nostalgie déchirante des jours précédant le départ, quand, incapable de prévoir la terrible échéance, on n’y pensait pas ou « faisait semblant » de n’y pas penser – « la vie […] ne sait pas entendre la mort approcher »– enfin la douleur aiguë de l’absence. C’est seulement après coup, hélas ! que certains menus faits peuvent recevoir une interprétation ; celle-ci permet de mesurer la solitude et sans doute la peur de celle qui allait partir, l’aide nécessairement incomplète du fils aimant en proie à de cruels regrets : « Je t’ai accompagnée, c’est sûr, mais / jusqu’où ? ». Sans craindre d’aviver sa souffrance, le poète revient avec une précision méticuleuse sur le moment fatidique ; le temps n’est plus désormais ce milieu homogène qui en faisait un flux continu : il y a maintenant « du temps mort sous le temps », du « temps écrasé sous le temps » – la mort étant toujours associée à des images qui la rendent « aussi lourd[e] qu’une roche barrant mon chemin » – et ce temps n’existe plus que dans la mémoire.
La mort de la mère donne au poète la liberté de parler et de mettre à jour, au-delà du tabou, les fondements de la relation mère-fils. Il regrette d’autant plus amèrement sa pudeur que la mort a pris possession du corps de la mère en des noces barbares, avec une autorité et une brutalité qui l’ont exclu. Celui qui vivait en empathie avec cette mère très aimée perçoit la violence du moment fatal comme la répétition de sa naissance, il se trouve une seconde fois arraché à elle, laissant échapper « de soi / le douloureux écho du cri de la naissance ». Le moment de la mort est celui d’une catastrophe au sens propre, « comme si la maison s’écroulait sur nous / deux », apocalypse emplie de « stupeur », qui n’en finit pas de « foudroyer ». Par ce mystère qui fait de la vie et de la mort « choses semblables » (Calderon), c’est la vie du fils qui, au moment où meurt la mère, « sembl[e] se défaire autour d’elle ». Cette brutalité ponctuelle va de plus agir, comme une bombe, à retardement ; la réalité de la mort déborde l’instant, elle « explose dans la vie » et se révèle terriblement « vivante », d’une vie familière, concrète et omniprésente, sur laquelle butent, dans chaque lieu, à chaque moment, les moindres gestes du quotidien. « J’ai mal à ma naissance », tel est le cri qui résume cette expérience de seconde naissance, un cri « qui vient pour la seconde / fois interroger le temps et la vie qu’elle m’avait / donnée ».
Ce qu’on appelle le travail de deuil sera ainsi une tentative de soigner une douleur analogue à celle qui rompt l’osmose prénatale – « je ne sais plus distinguer / ce qui est moi de ce qu’elle fut » – et de naître, autrement.
Richard Rognet n’en finit pas de se rappeler, avec chagrin : « Il pleut sur ta mémoire ».
S’impose pourtant et avant tout la conviction que « l’amour, oui l’amour demeure », il erre dans la maison dans le moindre objet, accroché à l’odeur des vêtements délaissés. La mère maintes fois évoquée s’impose comme une présence indéfectible, rassurante et « indispensable » – « elle était là, toujours » – présence aussi simple que celle des fleurs de son jardin et de ses plantes avec lesquelles elle entretenait une parenté naturelle, dans une relation de plain-pied analogue à l’échange chlorophyllien : « Les / plantes vertes touchaient, en secret, ce / qui de toi continuait à inventer des clartés / rassurantes ». La mère était à la source de la lumière, déesse créatrice d’un monde aux proportions de la nature : qu’elle parte, « on est orphelin des journées dont la lumière / grisait les oiseaux et les fleurs » ; morte, elle est « une fleur éteinte ».
Au plus fort de l’épreuve et de l’absence, n’a pas disparu le monde extérieur : la pluie, la neige ou le soleil font plus que créer une atmosphère, ils « proposent » au poète « des espaces » compatibles avec sa douleur. Ainsi s’impose malgré tout le sentiment, où se mêlent confiance et d’espérance, que la vie continue : de même qu’après trop de pluie et de grisaille, « on a envie » de lumière et de gaieté, de même un souvenir d’été peut survenir au milieu des souvenirs déchirants et « exploser » à l’improviste dans un chrysanthème de Toussaint. Sur le chemin de cette vie nouvelle, le poète reconnaît le prix de « son univers » dans lequel il inscrit son être : maison, village, saisons, toutes réalités dont il perçoit la voix, jusque dans leur souffle ou leur silence. Certains poèmes attestent sa capacité d’émerveillement restée intacte devant le foisonnement irrépressible de la vie et la beauté du monde. La sérénité procède de cette grandeur qui dépasse nos humbles destins. En toute chose il devient possible d’apprivoiser la mort de la mère, laquelle « devient la gloire de l’absence ».
Un autre motif d’apaisement est la permanence de la filiation : de la même manière dont la mère s’occupait des plantes, le fils nourrit les oiseaux, qui ont précisément partie liée avec la lumière naissante et le jour. Ces petits compagnons ailés, capables de « chasser de [la] maison » tristesses et regrets, ne sont-ils pas les meilleurs garants de cette perception des « frôlements infinis du monde », indispensable à la composition du poème salvateur ? Le fils doit désormais apprendre à vivre seul, il le pourra en s’appropriant le monde, avec ses fleurs, ses oiseaux, par le moyen de la poésie : « j’ai / compris que c’était avec ma propre voix […] que je devais / reconquérir ces noms, les dérober sans / crainte au poids du souvenir ».
Le poème moyen de délivrance, telle nous semble être la leçon de ténèbres à tirer de ces textes murmurés sur le mode de la plainte, plus lyriques que jamais. La douleur se traduit par la forme circulaire du poème, comme si la souffrance se refermait obsessionnellement en boucle sur le fils ; le rythme, par son ampleur, marque, quant à lui, la nécessité d’un flux ininterrompu de paroles pour conjurer l’absence et le silence. Le poème est bien le rescapé de la catastrophe et partant, réponse à l’incompréhension initiale, baume à la nostalgie de l’irrémédiable perte – celle de la mère, de l’enfance et de sa paix. Loin d’être une rupture, « La mort de la mère […] s’impose à moi […] comme un chemin de vie », voilà le constat final ; non seulement Richard Rognet revoit en souvenir son visage mais, au détour des phrases qu’il écrit, elle devient ce regard même qu’il pose sur toute réalité du monde, fût-ce la plus humble. Il a appris qu’il lui fallait vivre éclairé par « les étoiles qu’on invente en aimant », et que le passé a d’autant plus « la force d’embrasser le présent / et de se fondre en lui » dans l’harmonie, qu’il fut rempli d’un amour qui ne meurt pas, celui de ses parents, dont « le visage […] sourit devant toi ».
Chez Richard Rognet, le poème, seule parole acceptable, est consolation autant que louange ; il construit et libère.
Bibliographie partielle
Internet
Contribution de Béatrice Marchal
Cette maison, petite par sa structure mais grande par la rigueur de ses choix éditoriaux et par la grande qualité de son travail typographique, est devenue, au fil du temps une des figures incontournables du petit monde de l’édition poétique.