Yeux
primitifs
Là
où la peur ne raconte ni contes, ni poèmes, elle ne forme pas de
figures de terreur et de gloire.
Un vide gris est mon nom, mon
pronom.
Je connais la gamme des peurs et cette manière de
commencer à chanter tout doucement dans le dé-
filé qui
reconduit vers mon inconnue que je suis, mon émigrante de
moi.
J'écris contre la peur. Contre le vent et ses serres qui
se loge dans mon souffle.
Et quand, au matin, tu crains de te
retrouver morte (et qu'il n'y ait plus d'images) : le silence de
l'oppression, le silence d'être là simplement, voilà en quoi s'en
vont les années, en quoi s'en est allée la belle allégresse
animale.
In
L'enfer
musical ©
Ypsilon.éditeur 2012, traduit par Jacques Ancet, p.19
L'Enfer
musical est
le dernier livre d'Alejandra Pizarnik, née en Argentine, dans la
province de Buenos Aires, le 29 avril 1936, au sein d'une famille
d'émigrés juifs polonais, ayant fui le régime nazi et récemment
établis en
Amérique latine.
La vie y est difficile, ils sont sans nouvelles
 des leurs, restés en
Europe et la crainte d'Hitler ne les quitte pas. Une atmosphère qui
marquera profondément son enfance.
des leurs, restés en
Europe et la crainte d'Hitler ne les quitte pas. Une atmosphère qui
marquera profondément son enfance.
à
Olga Orozco
Temps
je
ne sais de l'enfance
qu'une
peur lumineuse
et une main qui me tire
vers mon autre
rive.
Mon enfance et son parfum
d'oiseau caressé.
In
Œuvre
poétique,Les aventures perdues (1958)
traduit
par Silvia Baron Supervielle
©
Actes Sud 2005, p.44
****
Fille
du vent
Ils sont venus.
Ils envahissent le sang.
Ils
sentent les plumes,
le dénuement,
les larmes.
Mais toi tu
nourris la peur
et
la solitude
comme deux petits animaux
perdus dans le
désert.
Ils sont venus
mettre le feu à l'âge du rêve.
Ta
vie est un adieu.
Mais toi tu étreins
comme la vipère folle
de mouvement
qui ne se trouve qu'elle-même
parce qu'il n'y a
personne.
Toi tu pleures sous tes larmes,
tu ouvres le
coffre de tes désirs
et tu es plus riche que la nuit.
Mais
il fait tant de solitude
que les mots se suicident
Ibid,in
Les
aventures perdues
(1958) p.45
Elle
commence à écrire dans des petits cahiers et publie, dès dix-neuf
ans, un premier petit recueil de poèmes en espagnol, La
tierra más arena et
un second l'année suivante, en 1956, La
ultima inocencia.
Après
avoir commencé des études de journalisme puis de Littérature
moderne, elle opte pour la peinture puis y renonce, faisant tout avec
passion mais en changeant plusieurs fois.
Elle
a en région parisienne un oncle, qui a survécu à l'occupation.
Pour échapper à la tutelle de sa mère, elle fait le choix de vivre
à Paris, où elle s'installe en 1960 ; elle y séjournera
jusqu'en 1964. “Ma seconde fugue a été mon départ en France”,
note-t-elle le 11 novembre 1960, dans son journal.
Sans
le sou, elle exerce plusieurs métiers dans l'édition, tout en
fréquentant la Sorbonne, écrit pour différents Cahiers, traduit en
espagnol des textes d'Antonin Artaud, d'Henri Michaux, d'André
Breton, d'Yves Bonnefoy, d'Aimé Césaire et de Marguerite Yourcenar.
Elle
quitte Paris à regret, en 1964, mais garde, après son retour en
Argentine, des relations épistolaires suivies à propos de poésie
et de littérature avec certains poètes devenus des amis, dont André
Pieyre de Mandiargues, Octavio Paz et Julio Cortázar.

Elle
vit, dès lors, dans un appartement minuscule à Buenos Aires et
consacre sa vie à l'écriture. Elle publie régulièrement dans
diverses revues latino-américaines tandis que paraissent plusieurs
de ses recueils en Argentine, Espagne, et Venezuela. L'œuvre est
dense, volumineuse, à la mesure de son exigence. Elle est reconnue
par ses pairs tandis que de jeunes poètes, comme son amie Ana
Becciú, ont recours à ses conseils.
En
1969, elle obtient une bourse de la Fondation Guggenheim et fait un
séjour d'études aux États-Unis.
Extrêmement
tourmentée et douloureuse, à la manière d'Artaud en qui elle se
reconnaît, elle reste terrifiée par une analyse entreprise dans sa
jeunesse, analyse qu'elle refuse de reprendre. En 1971, elle décide
cependant de revoir son psychiatre. Les médicaments n'apportent
aucune amélioration à son
équilibre psychique. Elle fait une tentative de suicide, en réchappe
de justesse mais est internée pendant cinq mois, jusqu'en janvier
1972.
Rentrée
chez elle, elle décédera le 25 septembre de la même année, à 36
ans, d'une trop forte dose de psychotropes. Acte volontaire ou
involontaire de sa part, on ne sait.
“Elle
a peut-être juste souhaité dormir” suggère
son amie Ana Becciú, qui lui a rendu visite la veille.
“Le
mieux c'est encore de dormir” écrivait-elle dans son journal, en
1960, devant l'ampleur de ses problèmes existentiels ; mais
elle y notait aussi “ne pas oublier de me suicider” et
évoquait cette urgence à de si nombreuses reprises, qu'on n'y
prêtait plus attention.
Dans
sa chambre, sur le petit tableau noir où elle inscrivait à la craie
des ébauches de poèmes, on retrouvera ce texte, daté de septembre
1972 :
*Criatura en plegaria
rabia
contra la niebla
escrito
en contra
el la
crepúsculo opacidad
no quiero ir
nada más
que hasta el fondo
oh
vida
oh
lenguaje
oh
Isidoro
*Créature
en prière / en rage contre la brume // écrit/ au / crépuscule //
contre l'opacité// je ne veux plus aller / nulle part /
qu'au tréfonds// oh vie/ oh langage / oh Isidore //
Elle
est cependant trop jeune pour être célèbre à son décès. Son
originalité lui vaut une réputation plus ou moins subversive. Une
grande partie de son œuvre poétique inédite, confiée précédemment
à un grand éditeur argentin et prête à paraître, va rester sous
le boisseau, par crainte de représailles de la part de ce dernier,
compte tenu du climat de tension politique interne, qui affecte le
pays.
Le
gouvernement en place s'effondre en effet en 1973 et l'Argentine
tombe alors sous la férule des généraux.
Un
régime de terreur s'installe,qui va contraindre au silence ou à
l'exil nombre d'artistes et d'amis du poète.
Les
inédits, restitués à sa famille, sont confiés à des amis sûrs,
qui les dissimulent de leur mieux. Olga Orozco tape en quatre
exemplaires tous les poèmes inédits. L'épouse de Julió Cortazar
quitte le pays avec ses Journaux, tandis qu'Ana Becciú emporte, en
1976, sa correspondance, qu'elle dépose à l'Université de
Princeton aux États-Unis.
En
France, c'est à Jacques Ancet que l'on doit, en 1983, la toute
première traduction de ses poèmes en français,
il
s'agit de L'autre
rive, paru aux
éditions Unes et suivi chez le même éditeur de À
propos de la comtesse sanglante, en
1999. Voici ce que dit son traducteur du choc de cette découverte : "C'est
grâce au poète et traducteur belge Fernand Verhesen que j'ai
découvert Alejandra Pizarnik en 1974. Il me fit parvenir, sous forme
d'une élégante plaquette, une petite anthologie qu'il venait de
traduire d'une poétesse qui m'était inconnue intitulée Où
l'avide environne. Et
là, ce fut une profonde émotion.
Une
émotion comme j'en ai connue rarement. Comparable à celle de la
découverte de Yannis Ritsos deux ans plus tôt. Une voix se faisait
entendre. Une voix blessée, obscure et innocente à la fois. Et qui
chantait. Une sorte de mélopée déchirante et douce marquée d'une
nostalgie indélébile d'une violence souterraine et d'une ombre
aveuglante que j'ai voulu alors traduire à mon tour."
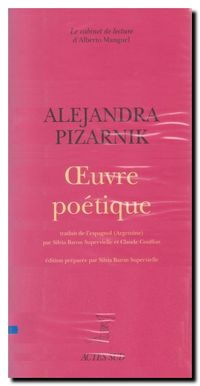 En
1986, François-Xavier Jaujard fait paraître aux éditions Granit,
Travaux de
nuits,
traduits et préfacés par Sylvia Baron Supervielle.
En
1986, François-Xavier Jaujard fait paraître aux éditions Granit,
Travaux de
nuits,
traduits et préfacés par Sylvia Baron Supervielle.
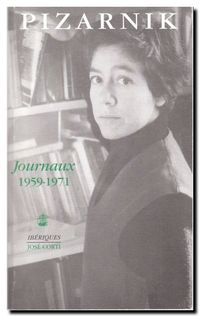
L'Œuvre
poétique, sera
également préparée et traduite par elle, avec la collaboration de
Claude Couffon, et paraîtra en 2005, chez Actes Sud, dans la
collection Le cabinet
de lecture,
dirigée
par un ami d'Alejandra, Alberto Manguel, qui en rédigera la
postface.
On
ne peut que regretter que cet ouvrage, très complet de 342 pages,
soit devenu introuvable, sauf en bibliothèque et qu'il ne figure
même plus au catalogue, sur le site de l'éditeur. À quand sa
réédition ?
Silvia
Baron Supervielle écrit dans la préface de ce livre: « Quelqu'un
se lance dans le vide, fait des tours sur soi-même et retombe dans
un lieu ignoré, mais reconnaissable, qui est un centre absolu. Le
poème exécute une voltige et se pose sur la terre, y créant un
nouveau battement.
(…)
Ce qui s'offrait à mes yeux œuvrait sur un champ intact que seules
les forces et la fureur de l'innocence étaient capables
d'atteindre.(...) très jeune, penchée sur ses écrits, Alejandra
brave déjà le danger imminent, mortel, prend des risques, s'expose
en se lançant toujours plus haut et plus loin dans le vide. Ses
signes recréent les blancs, les retiennent, les libèrent, recréent
les mots qui se plantent comme des couteaux dans le papier. La
résonance du silence y reste suspendue. Mais malgré la mort qu'elle
défie sans désemparer, elle hésite, elle a encore un léger
espoir. C'est un espoir extra-lucide dépourvu d'illusion. »
En
s'affranchissant d'emblée des règles de la poésie espagnole,
Alejandra Pizarnik affirme la richesse d'une vaste culture et laisse
libre cours à des audaces verbales et d'heureuses trouvailles.
La
cage s'est faite oiseau
et
a dévoré mes espérances.
(extrait)
In
l'Œuvre
poétique ©
Actes Sud 2005 p.61
Enfin,
l'édition française de ses Journaux
1959-1971, établie
et présentée de nouveau par Silvia Baron Supervielle et traduite de
l'espagnol par Anne Picard, paraît aux éditions José Corti, en
2010. Encore disponible, ce livre permet d'approfondir la
connaissance intime du poète et éclaire son œuvre.
Dans
son Journal, Alejandra Pizarnik se livre toute entière, avec ce trop
plein de passions, de désirs sexuels, de refus d'elle-même,
d'angoisse et de soif d'être aimée mêlés, qui la caractérise.
Mais
il est tant d'entrer avec Alejandra Pizarnik dans“son tragique
univers”, grâce à l’Œuvre
poétique, parue
chez Actes Sud.
Salut
L'île
s'enfuit
Et encore une fois la fille gravit le vent
et découvre
la mort de l'oiseau prophète
À présent
c'est le feu soumis
À
présent
c'est la chair
la feuille
la pierre
égarés
dans la source du tourment
comme le navigateur dans l'horreur de
la civilisation
qui purifie la tombée de la nuit
À présent
la
fille trouve le masque de l'infini
et casse le mur de la poésie.
In
Œuvre
poétique © Actes
Sud 2005, La
dernière innocence (1956),
p.21
****
Celle
des yeux ouverts
la vie joue dans le jardin
avec l'être
que je ne fus jamais
et je suis là
danse pensée
sur
la corde de mon sourire
et tous disent ça s'est passé et se
passe
ça va passer
ça va passer
mon cœur
ouvre la
fenêtre
vie
je suis là
ma vie
mon sang seul et
transi
percute contre le monde
mais je veux me savoir
vivante
mais je ne veux pas parler
de la mort
ni de ses
mains étranges.
Ibid,
p.23
Le
recueil suivant, Arbre
de Diane s'ouvre en
1962 sur une préface très originale de son ami, Octavio Paz.
L'écriture, davantage resserrée, a gagné en force évocatrice.
I
J'ai
sauté de moi jusqu'à l'aube.
J'ai laissé mon corps près de la
clarté
et j'ai chanté la tristesse de ce qui naît.
3
rien
que la soif
et le silence
nulle rencontre
prends garde
mon amour prends garde
à la silencieuse dans le désert
la
voyageuse au verre vide
prends garde à l'ombre de son ombre
7
Elle
saute, chemise en flammes,
d'étoile en étoile,
d'ombre en
ombre.
Elle meurt de mort lointaine
l'amoureuse du
vent.
10
un faible vent
peuplé de visages fermés
que
je découpe en forme d'objets à aimer
16
tu
as édifié ta maison
donné plumage à tes oiseaux
battu le
vent
avec tes os
tu as achevé seule
ce que nul n'avait
commencé
36
dans la cage du temps
la dormeuse regarde
ses yeux esseulés
le vent lui apporte, ténue,
la réponse
des feuilles
(extraits)
in Œuvre
Poétique © Actes
Sud, 2005, Arbre
de Diane (1962)
traduction de Claude Couffon p.71 à 106
En
1965, paraît Les
travaux et les nuits,
un recueil d'une telle intensité qu'on aimerait en transmettre
l'intégralité. Il s'ouvre magnifiquement sur ce petit
Poème
Tu
choisis l'endroit de la blessure
où nous parlons notre
silence.
Tu fais de ma vie
cette cérémonie trop pure.
In
Œuvre
poétique © Actes
Sud 2005, p.121
“La
Poésie est l'acte le plus pur dans la manière d'habiter
l'impossible” disait Jacques Dupin, peu avant sa mort. La poésie a
été pour Alejandra Pizarnik le point d'ancrage, grâce auquel elle
a sublimé sa douleur ; “écrire un poème, c'est réparer la
blessure fondamentale, la déchirure”dit-elle dans un entretien,
mais cette réparation ne lui suffit plus, semble-t-il. Elle est à
la recherche d'autre chose, que le lyrisme ne lui donne plus.
Enfance
Heure de l'herbe qui
pousse
dans la mémoire du cheval.
Le vent prononce des
discours ingénus
en l'honneur des lilas,
et quelqu'un entre
dans la mort
avec les yeux ouverts
comme Alice dans le pays du
déjà vu.
Ibid
p.140
****
Fête
J'ai
déplié mon orphelinage
sur la table comme une carte.
J'ai
dessiné l'itinéraire
vers mon pays au vent.
Ceux qui viennent
ne me trouvent pas.
Ceux que j'attends n'existent
pas.
Et j'ai bu des liqueurs furieuses
pour transmuer les
visages
en anges, en verre vides.
Ibid p.152
****
Les
yeux ouverts
Quelqu'un
mesure en sanglotant
l'étendue de l'aube.
Quelqu'un poignarde
l'oreiller
en quête de son impossible
place de repos.
Ibid p.153
****
Mendiante voix
Et
j'ose encore aimer
le son de la lumière à l'heure morte,
la
couleur du temps sur un mur abandonné.
Dans mon regard j'ai
tout perdu.
C'est si loin de demander. Si près savoir qu'il n'y a
pas.
Ibid
p.167
Extraction
de la pierre de folie, paraît
en 1968, titre qui évoque la folie qu'elle n'a cessée de redouter.
Brefs
mais intenses, les termes du poème, qui ouvre ce recueil ont été
repris ailleurs par elle, dans un hommage à son père, décédé
brutalement d'un infarctus en 1967.
Lanterne sourde
Les
absents soufflent et la nuit est dense. La nuit a la couleur des
paupières du mort.
Toute la nuit je fais la nuit. Toute la nuit
j'écris.
Mot à mot j'écris la nuit.
Ibid
p.175
À
leur tour, les éditions Ypsilon ont entrepris la publication
complète de son œuvre, en commençant par les derniers textes, avec
le projet de remonter peu à peu dans le temps. Traduits par Jacques
Ancet, quinze opus sont à paraître.
Les
deux premiers ont vu le jour en même temps, fin 2012, L'enfer
musical, son
dernier livre
et
Le Cahier jaune, “le
petit livre en prose” dont rêvait l'auteur. Une prose hachée
d'écorchée vive, un langage débridé et volontairement
provocateur.
Jacques
Ancet parle à son propos, sur son blog poétique, « d'assassinat
textuel », d'où son désir de la traduire et de la retraduire
grâce à ce qu'il perçoit d'elle, au jour d'aujourd'hui.
« C'est
donc ainsi que m'apparaît Alejandra Pizarnik, poursuit-il, une
possédée. Une possédée par une force de langage telle qu'elle
porte et traverse tout ce qu'elle écrit. Que ce soit poème, prose,
récit, théâtre, essai, c'est le même mouvement, la même
intensité qui est partout à l'œuvre. Or cette force de langage,
par un paradoxe consubstantiel à toute écriture poétique, cherche
ici à se débarrasser du langage pour n'être que vie pure. »
Vous trouverez sur le site du traducteur la suite de ses propos.
Les
citations, qui suivent, proviennent de ces deux dernières
traductions. Elles alterneront avec des extraits antérieurs de son
Journal.
De l'autre coté
Comme le
sable d'un sablier la musique tombe dans la musique.
Je suis
triste dans la nuit aux crocs de loup.
La musique tombe dans
la musique comme ma voix dans les voix.
In
L'enfer
musical ©
Ypsilon 2012, p.39
****
L'obscurité
des eaux*
J'écoute le bruit de l'eau
qui tombe dans mon sommeil. Les mots tombent comme l'eau moi je
tombe. Je dessine dans mes yeux la forme de mes yeux, je nage dans
mes eaux, je me dis mes silences. Toute la nuit j'attends que mon
langage parvienne à me configurer. Et je pense au vent qui vient à
moi, qui demeure en moi. Toute la nuit, j'ai marché sous la pluie
inconnue. On m'a donné un silence plein de formes et de visions
(dis-tu). Et tu cours désolée comme l'unique oiseau dans le vent.
* titre en français
Ibid p.49
****
25 mars 1961
Si
j'éprouve quelque chose d'infiniment doux quand j'écris ces
silences ou que surgissent les images de mes poèmes, il ne s'agit
pas du plaisir de créer mais plutôt de mon étonnement devant les
mots. Rien, ni personne en moi n'ose bouger, tourner, rouler. Rien ne
se met jamais en mouvement. Rien n'ouvre jamais la bouche, si ce
n'est pour mordre en silence. J'ai éprouvé douleur et silence. Je
souffre ou je me tais. Être bien, c'est être comme une statue.
Souffrir, c'est voir une couleur blanche qui court vers des chutes
ardentes. Ou bien, comme dans un film muet, le tigre qui dévore
lentement la jeune fille. Mon étonnement face à mes poèmes est
prodigieux.
In
Journaux
1959-1971, ©
José Corti 2010,
p.80
****
Contre
La
saveur des mots, cette saveur de vieille semence, de vieux ventre,
d'os qui fait perdre la tête, d'animal mouillé par une eau noire
(l'amour me contraint aux grimaces les plus atroces devant le
miroir). Je ne souffre pas, je ne dis que mon dégoût pour le
langage de ma tendresse, ces fils violets, ce sang coupé d'eau. Les
choses ne cachent rien, les choses sont les choses, et si quelqu'un
s'approche maintenant, et me dit d'appeler
un chat un chat, je
me mettrai à hurler et à me cogner la tête contre chacun des murs
infâmes et sourds de ce monde. Monde tangible, machines putassières,
monde en usufruit. Et les chiens m'offensant de leurs poils offerts,
léchant lentement et laissant leur salive sur les arbres qui me
rendent folle.
(extrait)
in Cahier
Jaune ©
Ypsilon 2012, p.9
****
Description
Tomber jusqu'à toucher le
fond ultime, désolé, fait d'un vieil étouffement et de figures qui
disent et répètent quelque chose qui m'évoque, je ne comprends pas
quoi, je ne comprends jamais, nul ne pourrais comprendre.
Ces figures –dessinées par
moi sur un mur – au lieu d'exhiber la belle immobilité qui
auparavant était leur privilège dansent et chantent à présent,
car elles ont décidé de changer de nature (si la nature existe, si
le changement, si la décision...).
C'est pourquoi dans mes nuits il
y a des voix dans mes os, et aussi – et c'est ce qui me fait me
plaindre – des visions de mots écrits mais qui bougent,
combattent, dansent, perdent leur sang, ensuite je les vois marcher
avec leurs béquilles, en haillons, cour des Miracles de a
jusqu'à
z,
alphabet
de misères, alphabet de cruautés...Celle qui a dû chanter est un
arc de silence, tandis que l'on susurre dans ses doigts, murmure dans
son cœur, que dans sa peau une plainte n'a pas de cesse...
(Il faut connaître ce lieu de
métamorphoses pour comprendre pourquoi je me fais souffrir d'une
manière aussi compliquée.)
Ibid
p. 36
****
Regard, le mien, collé aux grincements des choses. Monde de silence.
Besoin de m'inventer dans la nuit avec des mots qui me coûtent
tellement. Toujours la même soif avide, perverse, triste, comme une
couleur fanée dans la main, une plume déplumée . J'avale ma
soif, je la bois, la rumine avec un ennui invisible. Toutes les
nuits, mon regard se rebelle. Mes yeux se prennent au sérieux, se
rappellent, s'engagent : ils écartent les quais, les fleuves,
les livres et les visages qui se sont succédés sous le soleil
d'août. Mes yeux s'ouvrent. Ils m'obligent à les suivre dans des
altitudes d'ombre, de silence, de vent et de froid.
In
Journal,
11
août 1962, p.124
Ce
que j'ai écrit est la première version de mon enfer personnel. Je
clarifie les choses pour ma clarté personnelle. Je n'écris pour
personne.
(…) Et toi, tu resteras avec
ton amour impossible, flamboyante, enflammée, chevauchant un cheval
noir, fille nue surgissant de la nuit sur la plage, courant au son du
galop, de la mer et du cœur, et criant le nom de celui que tu aimes
avec une précision sauvage, jusqu'à ce que tu crées des éclairs,
des ténèbres, et que l'abîme ouvre à tes pieds son magnifique
gouffre et que tout retourne au chaos primordial.
Ibid 12 août 1962,
pages 127/128
Près
de dix ans plus tard, en octobre et novembre 1971, elle confie
encore à ce journal:
Les
mots sont plus terribles que je ne le pensais. Mon besoin de
tendresse est une longue caravane.
Quant
à l'écriture, je sais que j'écris bien, c'est tout. Mais cela ne
fait pas qu'on m'aime.
Écrire,
c'est donner du sens à la souffrance. J'ai tellement souffert qu'on
m'a déjà chassée de l'autre monde.
Elle
a le sentiment que l'art qu'elle poursuit lui échappe, alors même
qu'elle aspire à une nouvelle manière d'être au monde ; dans
la notice d'une anthologie française, consacrée aux poètes
d'Amérique latine, il est dit d'Alejandra Pizarnik : « qu'elle
sait que la force de la poésie peut conduire à un silence pur,
recherché, comme une sorte de perfection à laquelle aspireraient
les œuvres les plus tourmentées. »
En
pure perte
Les sortilèges émanent du
nouveau centre d'un poème adressé à personne. Je parle avec la
voix qui est derrière la voix et j'émets les sons magiques de la
pleureuse. Un regard bleu auréolait mon poème. Vie, ma vie,
qu'as-tu fait de ma vie ?
In
L'Enfer
musical © Ypsilon
2012, p.59
IV
Un jour, peut-être,
trouverons-nous refuge dans la réalité véritable. En attendant,
puis-je dire jusqu'à quel point je suis contre ?
Je te parle de solitude
mortelle. Il y a de la colère dans le destin parce que s'approche,
parmi les sables et les pierres, le loup gris. Et alors ? Parce
qu'il brisera toutes les portes, parce qu'il jettera les morts pour
qu'ils dévorent les vivants, pour qu'il n'y ait que des morts et que
les vivants disparaissent. N'aie pas peur du loup gris. Je l'ai nommé
pour vérifier qu'il existe et parce qu'il y a une volupté
inexprimable dans le fait de vérifier.
Les
mots auraient pu me sauver, mais je suis bien trop vivante. Non, je
ne veux pas chanter la mort. Ma mort...le loup gris...la tueuse venue
du lointain...N'y a-t-il âme qui vive dans la ville ? Parce que
vous êtes morts. Et quelle attente peut se changer en espérance si
vous êtes tous morts ? Quand cesserons-nous de fuir ?
Quand tout cela arrivera-t-il ? Oui quand ? Où ça ?
Comment ? Combien ? Pourquoi ? Et pour qui ?
Ibid p.66/67
Quoiqu'il
en soit, Alejandra Pizarnik a fait le choix la poésie et en dépit
d'un déchirement constant, elle a su faire preuve de lucidité,
d'humour et de ténacité, tout au long de sa vie. Souhaitons que son
œuvre soit lue et demeure, grâce à ceux qui nous la transmettent.
En
l'honneur d'une perte
La
certitude pour toujours d'être de trop à l'endroit où les autres
respirent. De moi je dois dire que je suis impatiente qu'on me donne
un dénouement moins tragique que le silence. Joie féroce quand je
rencontre une image qui m'évoque. À partir de ma respiration
désolante je dis : qu'il y ait du langage là où il doit avoir
du silence.
Quelqu'un ne s'énonce pas.
Quelqu'un ne peut pas s'assister. Et toi tu n'as pas voulu me
reconnaître quand je t'ai dit ce qu'il y avait en moi qui était
toi. La vieille terreur est revenue : n'avoir parlé de rien
avec personne.
Le jour doré n'est pas pour
moi. Pénombre du corps fasciné par son désir de mourir. Si tu
m'aimes je le saurai même si je ne vis pas. Et je me dis :
vends ta lumière étrange, ton enclos invraisemblable.
Un feu dans le pays non vu.
Images de candeur proche. Vends ta lumière, l'héroïsme de tes
jours futurs. La lumière est un excédent de trop de choses beaucoup
trop lointaines.
Je réside dans d'étranges
choses.
In
Cahier
Jaune ©
Ypsilon 2012, p.11

Internet
Contribution
de Roselyne
Fritel