 Le poème de la Chapelle Rothko fraie un passage de la
musique de la mer vers le cri, poème de « l’un primitif »,
où le Je voit le jour – jour renversé de rouge. Le rouge
de Rothko — ce noir vers le rouge — accomplit la geste du poète,
il martèle — une renverse de souffle — se déplace pieds nus sur
le sol, et dès ses premiers vers, le poète américain met en
mouvement un cercle précis de sons et de couleurs, il émet des
signes, et nous dansons au-dessus du volcan, « pour nous réunir
là » :
Le poème de la Chapelle Rothko fraie un passage de la
musique de la mer vers le cri, poème de « l’un primitif »,
où le Je voit le jour – jour renversé de rouge. Le rouge
de Rothko — ce noir vers le rouge — accomplit la geste du poète,
il martèle — une renverse de souffle — se déplace pieds nus sur
le sol, et dès ses premiers vers, le poète américain met en
mouvement un cercle précis de sons et de couleurs, il émet des
signes, et nous dansons au-dessus du volcan, « pour nous réunir
là » :
Rouge condensé par
noir rouge rendu dense par noir
progression de rouge
dense comme des marches de lave
rouge dense comme
des marches de lave pour nous réunir là
nous réunir avant
d’avoir à effectuer les passages
marches rouges nous
mènent à trois chambres rouges
chambres de lumière
rouge dense rouge condensé par noir
Traduit de l’américain
par Pierre Alféri et Emmanuel Hocquard, ce texte de John Taggart, —
né en 1942 dans l’Iowa, enseignant l’anglais à l'Université
Shippensburg — ce texte traverse la peinture, il scande une
architecture de sons et de couleurs.
La Chapelle Rothko,
bâtiment inscrit au National Register of Historic Places,
initialement a eu deux maîtres d’ouvrage — M. et Mme de Ménil,
lesquels ont confié en 1964 au peintre américain Mark Rothko —
maître d’œuvre aux côtés de quelques architectes —, la
création d’un espace de méditation enrichi de peintures. Le
résultat de cette commande est aujourd’hui libre d’accès au
visiteur : quatorze tableaux noirs, avec leurs nuances de
couleur, sont attachés à perpétuelle demeure à la Chapelle
Rothko, à Houston au Texas.
Que la couleur se dise,
que le poème de chair redresse sa colonne vertébrale, que le texte
élève ses ruines légères, tout cela revient à penser qu’ «
expérience poétique, expérience érotique et expérience mystique
n’en sont, au fond, qu’une seule. »1
Poème
— passage
Passage à l’acte
de créer. Serait-ce parce qu’il approcha l'Action Painting aux
côtés de Jackson Pollock et Adolph Gottlieb ? — ce texte
danse. Et ce qui semble être à l’œuvre, venir à
elle, appelé par elle, c’est justement le passage.
Passage souple.
Infiltrant le texte, passage mouillé, écriture liquide. Revenants
obscurs d’une mémoire archaïque, nous habitons un premier
souvenir, celui d’une « chambre » sombre et muette, jusqu’à
cet instant qui efface le noir et le silence, au détour d’une
cascade. Pauvre parole, pauvre lumière, qui chacune nous précipite
dans l’exil aussi sûrement qu’un étranger dans la foule d’un
pays inconnu. Cet instant de rupture, c’est « le seul cri que je
connais en vérité ».
Passage -
glissement, ce déplacement, ce mouvement seraient-ils ceux de la
langue « seul cri par le noir vers le rouge », « un seul cri
au-dedans », « des cris au-dedans d’un seul » ?
Passage du Il au Je, « m’emporte un cri au-dedans de
lui-même » ?
Passage sans porte,
sur un infini, sur une perception d’autrui, la peau de l’autre —
et cette « mer qui frissonne » ?
Passage-prison qui
trouve son échappée à l’enfermement sourd, bitumé, passage
après l’espace clos, et aussitôt l’on devine quelle asphyxie a
étreint celui qui se trouvait au bord de la délivrance. La
scansion, le rythme de ce long poème, par son recours métrique,
mesuré — littéralement battu —riche en figures prosodiques, en
allitérations, en constantes rythmiques, texte à l’ossature
mouvante —est-ce une hutte, un abri sur pilotis ? —- ce
poème en réalité envoûte. Le corps arpente, chorégraphie sa
magie rituelle, accompagne quelle sorte d’évènement inaugural ?
L’on devine bien qu’il s’agit de la naissance de la parole. «
Le seul enfant est le poète l’enfant de la douleur. » Dans
cette chambre noire résonnent des échos ; et l’on
s’interroge sur cette autre réalité plus fondamentale que
reflètent ces signes sonores. L’écoute — matrice du temps dans
le poème — s’avancerait-elle en ombre lointaine, passée autant
que projetée vers l’avenir ? Se pourrait-il qu’œuvrent, à
l’instar de la vérité platonicienne, des ombres sonores ou
poétologiques de la caverne ? L’écho ménage-t-il quelque
preuve, au procès des images et de l’Idéal, de cette autre
réalité selon laquelle le poème nous écoute davantage que nous
l’écoutons ?
Qui est-il cet enfant
de la douleur, à courir ainsi un seuil puis un autre, à emprunter
les traverses, qui est-il ce rôdeur qui n’a rien de considérable,
tant il semble perpétuellement venir au monde ? Cet errant pour
finir a des façons d’habitant, plus présent par sa fuite que
n’importe quelle instance installée à demeure. Le poète, en
habitant l’orée, le seuil et l’imminence, arpente l’espace
entier.
Passage de géomètre,
arpenteur des formes souples, cadastreur de l’air qui ne cesse
jamais, dans une rotation perpétuelle, d’accomplir le prodige du
vent. Si l’on y voit plus clair, cet empêcheur de tourner en rond
évite aux heures de s’enfoncer dans le sommeil, le poète est une
nappe phréatique, une trace de Voie lactée, sa solitude creuse les
chemins du temps et de l’espace ensemble, il disjoint puis
rassemble, recompose l'en bas et l’en haut, donne sa forme au
dedans, au dehors, son chemin de l’entr’appartenance
trace l’infini dans le fini, le précaire dans l’irréversible,
sa main de chiffonnier redonne corps, son travail de
défiguration/refiguration sans cesse recommence une infinie forme
inachevée.
Passage de
l’altérité : Je n’existe que par la main tendue
du Tu, ici se décèle l’appel — l’inquiétude en moins
— de Paul Celan, avec force de manque, sans illusion, sans
enchantement appuyé de la langue. « C’est l’heure de se
dé-pla-ha- cer », « l’heure de passer à l’action dans
cette langue », la solitude se rompt, place à l’accueil de
l’autre.
Passage pauvreté.
Quelques mots balisent la course de l’eau, tout juste prodiguant la
force du courant, clefs de voûte dans le fleuve d’encre : des
mots tels résignation, déplacer, marcher au pas, mariage, langue,
chambre, échos, échelle…faut-il le croire, ils dansent dans
l’oreille, ces mots si denses avec si peu de mots — réitérés
autant que les gouttes d’une averse sur le toit.
Poème
— architecture
Dix, douze vocables si
essentiellement liés, un rideau de pluie droite dans le soleil,
phrases d’une maison liquide. « Une phrase est un choix »,
celles-ci coulent, se mettent à nu, se réitèrent, répétitives,
puis à nouveau se déshabillent. Ce serait cela, écrire : une
architecture de l’eau, avec ses poutres en fer et ses murs de
verre, ses bois flottés, et tout serait là, dans ce bagage léger.
Le rouge en train de se dire. Le rouge interroge la géométrie de
l’eau parlante. Le texte interroge le texte, la fondation creuse
encore le néant de la couleur : rouge, un noir qui devient
rouge. La chambre noire du brouhaha — chambre initiale — s’occupe
de ce qui est dit, ne s’occupe que de cela : devenir. Elle
accomplit l’œuvre alchimique, avec de rares signes en guise de
soubassement, et si le texte se fait chapelle, elle est sans nul
doute romane — à l’espace si repoussé que le vide induit un
puissant appel d’air, une respiration, la place d’un écho
intime. Lorsque le chamane évoque un « moi rose », est-ce
pour signifier le « nettoyage de la situation verbale »2?
Sans doute non. Et peut-être oui après tout, pourvu que l’on
attrape la clef donnée à la fin de la transe : « moi rose (…)
moi s’adressant à moi prêt à être lui-même » ?
Quelque chose a changé, dissocié d’une fusion allégorique, tout
se sépare, la peau est nettoyée, neuve, douce. Ce passage
symbolique traversé par le poète de la Chapelle Rothko a exploré
un commencement. Devenir ? Autant dire partir. D’une nage
lente, en descendant le fleuve.
Poème
— commencement
Au commencement était
le bégaiement. Plus encore que la création, le créateur apparaît
pétri de contradictions. Le poème de la Chapelle Rothko traverse,
mais quel pont franchit-il ? Que voit-on ? Pour lumineuse
et volontaire que soit la défaite de l’illusion lyrique, tout s’y
joue dans la pénombre : « ni parole édifiante, ni effusion de
sentiments. »3
Près d’une petite lampe de contradictions, on assiste ici à la
déclaration de guerre en creux du poème contre lui-même, quelqu’un
avec ses chaînes lourdes tend ses mains vers l’universalité,
quelqu’un crée, de rage il piétine sa finitude de mortel, il
murmure sa solitude vers l’autre, cet homme traverse, il se cherche
querelle, sans repos il se défie de lui, il s’arrête, il se
dispute seul. Qu’il tende vers une pensée, aussitôt il en prend
le contrepied de peur qu’elle soit courbée sous quelque pâle
instinct ; qu’il désire serrer de plus près ce dessein,
aussitôt il l’abandonne pour cette maîtrise singulière que
prodigue le dénuement. Il renaît d’une souffrance, ignorant qui
pourtant veille sur la langue, tire sa victoire intime d’un refus
ontologique de combattre avec pareilles armes — l’ombre de la
parole certes (sa chair dirait Celan), pourtant ni sa
perversion, ni le cirque —, n’ayant rien d’autre à gagner que
soi, traducteur tendu vers le déchiffrement de soi, de l’autre et
de l’alphabet, pleinement occupé à sa propre clairvoyance, il est
un mouvement perpétuel dans le soir, il dialogue avec la nuit et le
silence, infatigable voyageur de chambre — tels Joë Bousquet
contraint, ou Cristina Campo libre de ses mouvements, mais écrivant
chacun au fond de leur lit, — extravagant athée ( Dieu merci !),
exilé dans l’entre-deux, le poète déplie, retourne, contredit,
il s’inverse. Le cuir des souliers a blessé ses pieds, ce qu’il
cherche ? La présence, la sève et le feu désappris chaque
matin.
Mark Rothko était
fortement imprégné de La naissance de la tragédie
nietzschéenne. Comment soulager la modernité de son poids de vide
spirituel, comment libérer les énergies inconscientes de l’homme
contemporain là où
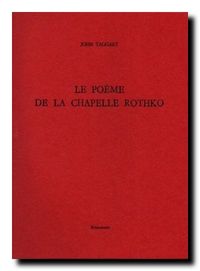 les symboles et la mythologie ne jouent plus
désormais ce rôle ? La problématique demeure ouverte, et
autant dire que la mort de l’illusion lyrique aggrave la question
du sens. La question sur les lèvres se murmure : et après ?
Après le désenchantement ? Après l’envol et la chute ?
Qu’y a-t-il après ? Peut-être les énergies créatrices de
la rencontre, ses contradictions libératoires au cœur de la foudre.
les symboles et la mythologie ne jouent plus
désormais ce rôle ? La problématique demeure ouverte, et
autant dire que la mort de l’illusion lyrique aggrave la question
du sens. La question sur les lèvres se murmure : et après ?
Après le désenchantement ? Après l’envol et la chute ?
Qu’y a-t-il après ? Peut-être les énergies créatrices de
la rencontre, ses contradictions libératoires au cœur de la foudre.
Après le vide, il y
aurait cela : une renaissance de plus, une encore, profonde, toile
monochrome à la surface mouvante, aux bords indécis, mouvement
ample d’une langue qui danse — ailleurs sur une autre mer, sur
une autre scène.
Bibliographie
partielle
-
Le
poème de la Chapelle Rothko,
Traduit de l’américain par Pierre Alféri et Emmanuel Hocquard,
Éditions Royaumont, Collection Un bureau sur l’Atlantique, 1990
Internet
Contribution
de Sylvie-E.
Saliceti