 Guy Goffette est né le 18 avril 1947 dans une petite ville de la Lorraine belge. Enseignant, puis libraire et éditeur des cahiers de poésie Triangle et de l’Apprentypographe, (années 1980), il travaille dans l’édition, (lecteur pour les Éditions Gallimard), et siège dans les jurys de poésie.
Guy Goffette est né le 18 avril 1947 dans une petite ville de la Lorraine belge. Enseignant, puis libraire et éditeur des cahiers de poésie Triangle et de l’Apprentypographe, (années 1980), il travaille dans l’édition, (lecteur pour les Éditions Gallimard), et siège dans les jurys de poésie.
Cette Lorraine belge où il est né est une terre féconde en poètes, (patrie de Rimbaud et de Verlaine). Mais bien qu’ayant parcouru de nombreux pays d’Europe, il se sent proche de Verlaine, le voyageur immobile. Sa poésie plonge ses racines dans cette terre ardennaise. Son inspiration s’est nourrie de promenades dans la nature, de silence, de vie simple. Et comme Verlaine, il se sent davantage voyageur dans le temps que dans l’espace.
Son entretien avec Bruno Berchoud, ( revue Décharge 2009), constitue une véritable profession de foi 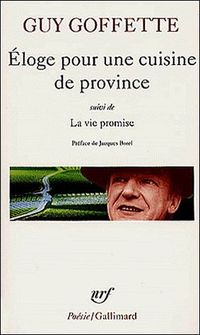 de ce que qu’est pour lui sa conception de la vie et de l’écriture.
de ce que qu’est pour lui sa conception de la vie et de l’écriture.
« Nous sommes des passagers sur une terre qui tourne dans l’espace, et nos voyages finalement sont immobiles. L’important est de demeurer en partance, de ne pas s’installer, de ne pas devenir des « assis », comme disait Rimbe. «La vraie vie rimbaldienne s’écrit au présent. Le seul moment, le seul lieu où nous sommes vraiment c’est le présent. Être présent au présent, à « l’hic et nunc », être pleinement soi dans la douleur comme dans la joie, il n’y a pas d’autre moyen de goûter ici même à l’éternité… Il faut « être » absolument être….. vivre c’est autre chose c’est autre chose qu’exister, c’est être et la vie pour moi ne meurt pas, seule l’existence a une fin. J’écris pour vivre, c’est-à-dire pour devenir ce que je suis et que je ne connais pas »
La poésie de Guy Goffette, comme celle de Verlaine, est une poésie imprégnée de tonalité musicale. « En général, dit-il le premier vers m’est donné, c’est le « la » du poème, qui va suivre ou se perdre. C’est lui qui impose la tonalité du morceau que je ne quitterai qu’après le dernier coup d’archet » Cette musicalité est qualifiée par lui de « musicalité sans fioritures », (airs populaires, fado, chants tziganes, yiddish…)
La peinture n’est pas non plus absente dans l’inspiration de son œuvre littéraire. Sa première vocation contrariée par son père, était la peinture. Cette vocation contrariée se retrouve dans un certain regard du poète sur le monde. Il consacre un livre à Pierre Bonnard, Elle et toujours nue (Gallimard 1998) sur la relation du peintre avec sa femme et modèle, Marthe. Toujours dans l’entretien que lui consacre Bruno Berchoud, il déclare : « le trouble que ce tableau a suscité en moi, (le tableau de Marthe par Bonnard), est moins dû à la qualité de la peinture qu’à son sujet, à ce que la toile cachait ou me révélait… Les vrais déclencheurs d’écriture, chez moi, sont plutôt des sentiments, des sensations, des états d’âme, que des faits ou des choses réelles. »
Superbe conclusion à l’entretien avec Bruno Berchoud, Guy Goffette s’exprimant sur la guerre entre poètes lyriques et anti-lyriques : «la guerre des mots ne fait que des morts de papier, tandis que les rivières continuent de couler comme l’encre des poètes drainant quelques perles pour enrichir l’espérance ».
Guy Goffette a reçu de nombreuses distinctions : dont le Grand Prix de poésie de l’Académie française en 2001 et le Prix Goncourt de la poésie en 2010.
Je me disais aussi : vivre est autre chose
que cet oubli du temps qui passe et des ravages
de l’amour, et de l’usure – ce que nous faisons
du matin à la nuit : fendre la mer,
fendre le ciel, la terre, tour à tour oiseau,
poisson, taupe, enfin : jouant à brasser l’air,
l’eau, les fruits, la poussière ; agissant comme,
brûlant pour, allant vers, récoltant
quoi ? le ver dans la pomme, le vent dans les blés
puisque tout retombe toujours, puisque tout
recommence et rien n’est jamais pareil
à ce qui fût, ni pire ni meilleur,
qui ne cesse de répéter : vivre est autre chose.
In La Vie promise, © Gallimard, Paris, 1991, coll. Blanche. Rééd. En 1994, 1997, 2001.
EN FÉVRIER 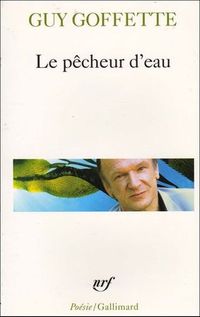
Lui aussi croyait en sa force de tigre
Et que la jeunesse est immortelle.
Il savait par cœur le chemin et le goût
du lait dans le bol ébréché,
mais que le sang fût amer et froid le métal
dans la tiédeur de l’aube : non. Un frisson
a parcouru son poil ébouriffé, libérant
un brin d’herbe si vert que j’ai suivi
des yeux son preste envol, le temps
d’un souffle, juste ce qu’il faut à la mort
pour traverser une vie de chat à jeter,
dans un bol de lait, sur,
une belle journée de soleil, à jamais ébréchée.
In La Vie promise, © Gallimard, Paris, 1991, coll. Blanche. Rééd. En 1994, 1997, 2001.
(Lettre à l’inconnue d’en face, 3)
Reconnaissez Madame que mourir
hors du dérèglement de tous les sens
est triste et sans aucun profit (présent
gâché par la vertu, la nuit vient vite
et la plus belle rose est du fumier).
Ouvrez vos ombres votre giron vos
Lèvres : le clou du spectacle est en bas
Dans une rue où preste comme une main
Sous les robes, le vent réveille les
Beaux orages qui nous étaient promis.
In Un manteau de fortune, © Gallimard, Paris, 2001, coll. Blanche
Ce qui est grave, ce n’est pas de n’avoir
qu’un manteau de fortune, une seule paire
de chaussures éreintées quand il neige
et que le vent froid souffle en rafales
ni que la plomberie de la chambre soit aussi
pourrie que les bronches du fumeur, les artères
des villes bombardées, les paroles des faux
prophètes et les promesses des gouvernants
ni que le marchand de vin refuse
obstinément tout nouveau crédit
alors que l’eau du robinet a le goût
du rat crevé, ni que le ciel s’éloigne
à mesure que nous grandissons, et la terre
tout à coup colle à nos pieds, l’ombre
qui nous suivait bientôt nous distance
et c’est la nuit comme un voleur, fracassant
le regard du voyageur arrêté
au milieu des valises qui emporte
avec la clef du paysage la route et
la soif et le sel de vivre. Ce qui est grave,
disait-il, c’est d’avoir oublié que l’homme
secoué par les vagues d’ennuis divers
et de détresse, est plus vaste et profond
que la mer mais plus fragile
que feuille d’automne si, dressé
contre lui-même dans la prison du corps
battu, il ne sait plus rendre grâce
au présent pour la vie qui fleurit
sur un visage où flambe comme rose.
In Un manteau de fortune, © Gallimard, Paris, 2001, coll. Blanche
Le jour est si fragile, à la corne du bois
que je ne sais plus où ni comment ce matin
poser mes yeux, ma voix, poser ce corps d’argile
si drôlement qui craque à la croisée des ombres.
J’ai peur soudain, ou peur de n’être que cela :
une poignée de terre qu’un souffle obscur de l’aube
tient dans sa paume, et qu’il ne s’épuise d’un coup
et me laisse tomber dans la poussière du temps,
comme ces fruits qu’aucune bouche n’a touchés
et qui roulent sans fin dans la nuit des famines
Seigneur, si vous êtes ce souffle obscur et si
Fragile à la corne du bois, et si je suis
ce corps, resserrez votre paume, resserrez-la.
In L'Adieu aux lisières, © Gallimard, 2007, coll. Blanche
Nous avons cru longtemps qu’il nous suffisait
d’allonger le bras pour toucher le ciel
et tenir en laisse le vieil horizon
si longtemps qu’en nous le geste demeure
à la vue d’une femme à l’aube surprise
lavant dans ses larmes le jour et la nuit
que plus rien ne reste à la fin que l’ombre
pour raser de frais au fil de l’amour
nos corps effondrés dans la chambre avec
le ciel comme un bas sur un parquet nu.
In L'Adieu aux lisières, © Gallimard, 2007, coll. Blanche
Bibliographie
Internet
Contribution de Hélène Millien
L'exposition Edvard Munch. L’œil moderne a débuté le 21 septembre dernier au Centre Georges Pompidou et se poursuivra jusqu'au 9 janvier 2012 ; elle nous présente une nouvelle facette de son œuvre, des toiles de la première moitié du XXème siècle, fortement influencées par l'irruption de l'image dans la vie quotidienne, où l'artiste saisit son sujet à la façon d'un appareil photographique ou d'une caméra.
Ce rapprochement texte-tableau, Munch-Mandelstam, le voici brillamment illustré par l'analyse des poèmes de cette période, dont L'homme qui trouve un fer à cheval, que fait Florian Rodari, dans l'introduction à La Revue des belles-Lettres, consacrée au poète Mandelstam : « D'allure généralement lente et grave, les poèmes éclatent à leur surface en déflagrations sonores, se brisent en ellipses foudroyantes, en ruptures qui précipitent l'esprit à la rencontre de propositions nouvelles, révélatrices ; les amples métaphores qui ordonnent le corps sémantique reculent devant l'insistance des couleurs, des parfums, des profils fortement accusés, renaissant plus tard enrichies de ces soudains vertiges ; tantôt la haute pensée qui guide le poète refrène la hâte des sens et la volupté du verbe, tantôt elle lui cède .