Être
publié de son vivant dans La Pléiade est tout-à-fait exceptionnel.
Or ce fut le cas de Saint-John Perse, comme plus tard de René Char.
Mais il est encore plus remarquable de constater que c’est l’auteur
lui-même qui s’est chargé de l’édition du volume de ses œuvres
complètes,
 avec notamment la rédaction de sa notice biographique,
qui selon Mireille Sacotte est « le chef-d’œuvre d’un
faussaire » (Revue Europe, 1995, p. 137), tellement il
s’autorise des libertés avec la réalité, comme le montre Renée
Ventresque dans son livre La « Pléiade » de
Saint-John Perse, La poésie contre l’histoire, paru
en 2011.
avec notamment la rédaction de sa notice biographique,
qui selon Mireille Sacotte est « le chef-d’œuvre d’un
faussaire » (Revue Europe, 1995, p. 137), tellement il
s’autorise des libertés avec la réalité, comme le montre Renée
Ventresque dans son livre La « Pléiade » de
Saint-John Perse, La poésie contre l’histoire, paru
en 2011.
Rarement
un écrivain aura autant voulu contrôler l’image qu’il désire
transmettre de lui-même à la postérité, n’hésitant pas à
réécrire un certains nombre de lettres de sa correspondance.
Lui-même s’est d’ailleurs désigné par trois noms : Alexis
Leger, Saint-Leger Leger, Saint-John Perse. D’où cette appellation
du site qui lui est consacré : « Saint-John Perse, le
poète aux masques ». Qui se cache donc sous cet étrange nom,
Saint-John Perse ?
Alexis
Leger est né en 1887, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, où il
passe sa petite enfance, dans les domaines des plantations de café
de La Joséphine, appartenant aux Dormoy-Le Dentu, sa famille
maternelle, et les plantations de canne à sucre de Bois-Debout,
propriété de sa famille paternelle. Mais la crise économique de
1897 les oblige tous à quitter l’île, pour regagner la France en
1899 et s’installer à Pau. La réminiscence de ses premières
années dans cet Éden tropical des Antilles inspire au poète son
premier recueil, Éloges,
publié en 1911. Une
célébration de l’enfance, au milieu d’une nature luxuriante,
au-delà de toute nostalgie. Son île natale perdue est devenue l’île
rêvée.
Images
à Crusoé
Crusoé !
– ce soir près de ton île, le ciel qui se rapproche louangera la
mer, et le silence multipliera l’exclamation des astres solitaires.
Tire
les rideaux ; n’allume point :
C’est le soir sur
ton île et à l’entour, ici et là, partout où s’arrondit le
vase sans défaut de la mer ; c’est le soir couleur de
paupières, sur les chemins tissés du ciel et de la mer.
(…)
L’oiseau
se berce dans sa plume, sous un rêve huileux ; le fruit creux,
sourd d’insectes,
tombe dans l’eau des criques, fouillant son bruit.
L’île
s’endort au cirque des eaux vastes, lavée des courants chauds et
des laitances grasses, dans la fréquentation des vases somptueuses.
(…)
Vagissements
des eaux tournantes et lumineuses !
Corolles,
bouches des moires : le deuil qui point et s’épanouit !
Ce sont de grandes fleurs mouvantes en voyage, des fleurs vivantes à
jamais, et qui ne cesseront de croître par le monde…
Ô
la couleur des brises circulant sur les eaux calmes, les palmes des
palmiers qui bougent !...
(…)
Joie !
ô joie déliée dans les hauteurs du ciel !
…Crusoé !
tu es là ! Et ta face est offerte aux signes de la nuit, comme
une paume renversée.
In
Éloges,
Œuvres
Complètes, La Pléiade, © Gallimard, 1972, p. 13-14
Ayant
choisi la carrière diplomatique, Alexis Leger est envoyé en poste à
Pékin en 1916, avec des séjours en Mandchourie, en Corée et en
Mongolie, où il effectue la traversée du désert de Gobi. Remarqué
par Aristide Briand, il entre au Quai d’Orsay en 1922, est nommé
directeur de cabinet en 1925, puis secrétaire général au Ministère
des Affaires Étrangères en 1933, devenant le conseiller par
excellence de la politique extérieure française jusqu’en 1940.
Durant cette période où règne le pacifisme, ses positions de
fermeté à l’égard de l’Allemagne lui vaudront d’être
dénoncé comme « belliciste », révoqué, puis déchu de
la nationalité française par Vichy. Le 16 juin 1940, il quitte la
France pour s’exiler aux États-Unis.
En
1924 il publie à la N.R.F., Anabase,
sous le pseudonyme de Saint-John Perse. Sur un haut plateau désert,
où passe le vent, on entend des discours lointains. Tout s’est
effondré, les civilisations ont disparu et le vent porte la parole
des grands hommes constructeurs, la voix mélancolique des
conquérants, qui disent : « Nous n’habiterons pas
toujours ces terres jaunes, notre délice… ». Seuls
demeurent, sur ce haut plateau désert, les derniers compagnons du
poète, la pluie, la neige et le vent, puis tout s’efface. Ce
grand poème épique de la solitude dans l’action marque un
tournant décisif dans son œuvre. Une sorte d’inventaire du monde
et de ses richesses. Un appel ardent au départ, à la conquête des
grands espaces, qui est aussi conquête spirituelle.
Certes !
une histoire pour les hommes, un chant de force pour les hommes,
comme un frémissement du large dans un arbre de fer !...lois
données sur d’autres rives, et les alliances par les femmes au
sein des peuples dissolus ; de grands pays vendus à la criée
sous l’inflation solaire, les hauts plateaux pacifiés et les
provinces mises à prix dans l’odeur solennelle des roses…
Ceux-là
qui en naissant n’ont point flairé de telles braises, qu’ont-ils
à faire parmi nous ? et se peut-il qu’ils aient commerce de
vivants ? (…) « Je connais cette race établie sur les
pentes : cavaliers démontés dans les cultures vivrières.
Allez et dites à ceux-là : un immense péril à courir avec
nous ! des actions sans nombre et sans mesure, des volontés
puissantes et dissipatrices et le pouvoir de l’homme consommé
comme la grappe dans la vigne…Allez et dites bien : nos
habitudes de violence, nos chevaux sobres et rapides sur les
semences de révolte et nos casques flairés par la fureur du jour…
Aux pays épuisés où les coutumes sont à reprendre, tant de
familles à composer comme des encagées d’oiseaux siffleurs, vous
nous verrez, dans nos façon d’agir, assembleurs de nations sous de
vastes hangars, lecteurs de bulles à voix haute, et vingt peuples
sous nos lois parlant toutes les langues…
(…)
Mais
au soir, une odeur de violettes et d’argile, aux mains des filles
de nos femmes, nous visitait dans nos projets d’établissement et
de fortune
et
les vents calmes hébergeaient au fond des golfes désertiques.
In
Anabase,
ibid. p.
102-104
Alexis
Leger en devenant homme politique s’est imposé une longue phase de
silence, qui se prolonge jusqu’à son départ en exil. À son
arrivée à New-York, le 14 juillet 1940, il a tout perdu : ses
biens confisqués, son appartement parisien mis à sac, ses
manuscrits brûlés. Proscrit, apatride et sans ressources, son
désarroi est extrême. Mais rapidement il obtient le soutien et
l’aide matérielle de riches amis américains, ainsi qu’un poste
de consultant littéraire à la bibliothèque du Congrès de
Washington.
Et
très vite c’est le retour à la création littéraire pour le
poète « restitué à sa rive natale ». Cette fois se
sont les paysages américains qui l’inspirent. À commencer par les
grandes plages de Long Beach Island, dans le New-Jersey, où il écrit
Exil,
en 1941, un poème imprégné de l’hospitalité qui lui est
offerte et de ce paysage qui traduit le sentiment d’un vide
radical.
« …Comme
celui qui se dévêt à la vue de la mer, comme celui qui s’est
levé pour honorer la première brise de terre ( et voici que son
front a grandi sous le casque),
« Les
mains plus nues qu’à ma naissance et la lèvre plus libre,
l’oreille à ces coraux où gît la plainte d’un autre âge,
« Me
voici restitué à ma rive natale…Il n’est d’histoire que de
l’âme, il n’est d’aisance que de l’âme.
« Avec
l’achaine, l’anophèle, avec les chaumes et les sables, avec les
choses les plus frêles, avec les choses les plus vaines, la simple
chose, la simple chose que voilà, la simple chose d’être là,
dans l’écoulement du jour…
« Mais
qu’est-ce là, oh ! qu’est-ce, en toute chose, qui soudain
fait défaut ?... »
In
Exil, ibid.
p.130
En
1943, alors qu’il se trouve à Savannah, en Caroline du Sud, où il
visite d’anciennes plantations et découvre la trace d’émigrés
français de sa famille au 18ème siècle, le spectacle
rédempteur des intempéries lui inspire le poème Pluies.
« Ô
Pluies ! lavez au cœur de l’homme les plus beaux dits de
l’homme : les plus belles sentences, les plus belles
séquences ; les phrases les mieux faites, les pages les mieux
nées. Lavez, lavez, au cœur des hommes, leur goût de cantilènes,
d’élégies ; leur goût de villanelles et de rondeaux ;
leurs grands bonheurs d’expression ; lavez le sel de
l’atticisme et le miel de l’euphuisme, lavez, lavez la literie du
songe et la litière du savoir : au cœur de l’homme sans
refus, au cœur de l’homme sans dégoût, lavez, lavez, ô
Pluies ! les plus beaux dons de l’homme… au cœur des hommes
les mieux doués pour les grandes œuvres de raison. »
In
Pluies, ibid.
p.151
De
même que les matins neigeux de New-York lui inspirent en 1944 le
poème Neiges, le paysage de Seven Hundred Acre Island, une
île sauvage propice aux fortes bourrasques, sur les côtes du Maine,
sert de cadre en 1945 à son poème Vents.
… Nous
reviendrons un soir d’Automne, avec ce goût de lierre sur nos
lèvres ; avec ce goût de mangles et d’herbage et de limon au
large des estuaires.
Nous
reviendrons avec le cours des choses réversibles, avec la marche
errante des saisons, avec les astres se mouvant sur leurs routes
usuelles…
Et
le Vent, ha ! le Vent avec nous, dans nos desseins et dans nos
actes, qu’il soit notre garant !...
« …Pétrels,
nos cils, au creux de la vision d’orage, épelez-vous lettre
nouvelle dans les grands textes épars où fume l’indicible ?
« Vous
qui savez, rives futures, où s’inscriront nos actes, et dans
quelles chairs nouvelles se lèveront nos dieux,
« Gardez-nous
un lit pur de toute défaillance, une demeure libre de toute cendre
consumée… »
In
Vents,
IV, ibid.
p.241-242
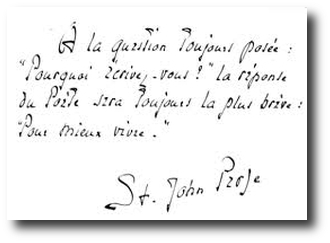 Le
poème Vents est
publié en 1946, chez Gallimard, en édition de luxe, limitée à
2425 exemplaires numérotés. Une œuvre majeure, dont Claudel
s’enthousiasme. Sollicité cette même année pour le poste de
directeur général adjoint de l’UNESCO, Perse décline l’offre,
préférant à la vie publique en France l’indépendance littéraire
aux USA, où il obtient en 1949 le statut de résident permanent.
Le
poème Vents est
publié en 1946, chez Gallimard, en édition de luxe, limitée à
2425 exemplaires numérotés. Une œuvre majeure, dont Claudel
s’enthousiasme. Sollicité cette même année pour le poste de
directeur général adjoint de l’UNESCO, Perse décline l’offre,
préférant à la vie publique en France l’indépendance littéraire
aux USA, où il obtient en 1949 le statut de résident permanent.
Il
consacre alors les dix années qui suivent à son œuvre maîtresse,
Amers,
poème de la plus longue maturation, à la structure rigoureuse,
théâtralisée sur le modèle de la tragédie grecque, publié en
1957. L’auteur s’est expliqué sur la thématique de ce poème : «
C’est l’intégrité même de l’homme que j’ai voulu dresser
sur le seuil le plus nu, face à la nuit splendide de son destin en
cours. Et c’est la Mer que j’ai choisie, symboliquement, comme
miroir offert à ce destin – comme lieu de convergence et de
rayonnement…en même temps que réservoir de forces éternelles
pour l’accomplissement et le dépassement de l’homme, cet
insatiable migrateur » (La Pléiade, p. 569-570). La puissance
de la mer symbolisant à la fois le mouvement de la vie, le désir
amoureux et la parole poétique.
« Tu
es aussi l’âme nubile et l’impatience du feu rose dans
l’évasement des sables ; tu es l’arôme, et la chaleur,
et la faveur même du sable, son haleine, aux fêtes d’ombre de la
flamme. Tu sens les dunes immortelles et toutes rives indivises où
tremble le songe, pavot pâle. Tu es l’exclamation du sel et la
divination du sel, lorsque la mer au loin s’est retirée sur ses
tables poreuses. Tu es l’écaille, et le feu vert, et la couleuvre
de feu vert, au bas des schistes feuilletés d’or, là où les
myrtes et l’yeuse naine et le cirier des grèves descendent au feu
de mer chercher leurs taches de rousseur…
«
Ô femme et fièvre faite femme ! lèvres qui t’ont flairée
ne fleurent point la mort. Vivante – et qui plus vive ? – tu
sens l’eau verte et le récif, tu sens la vierge et le varech, et
tes flancs sont lavés au bienfait de nos jours. Tu sens la pierre
pailletée d’astres et sens le cuivre qui s’échauffe dans la
lubricité des eaux. Tu es la pierre laurée d’algues au revers de
la houle, et sais l’envers des plus grands thalles incrustés de
calcaire. Tu es la face baignée d’ombre et la bonté du grès. Tu
bouges avec l’avoine sauvage et le millet des sables et le gramen
des grèves inondées ; et ton haleine est dans l’exhalaison
des pailles vers la mer, et tu te meus avec la migration des sables
vers la mer…
In
Amers, ibid.
p. 333-334
L’année
1957 est aussi celle de son retour en France, après 17 ans d’exil.
Il s’installe en Provence, dans la presqu’île de Giens, aux
Vigneaux, une villa qu’une amie américaine, Mina Curtiss, lui
offre et qui deviendra chaque année son port d’attache français,
tandis qu’il passera les six autres mois aux USA. En 1958, il
épouse à 70 ans Dorothy Milburn Russell, une Américaine qu’il
rebaptise Diane. Cette même année il rédige en terre provençale
Chronique, qui sera publié en 1960, chez Gallimard. André
Malraux lui remet en 1959 le Grand Prix National des Lettres.
Les
8 chants de Chronique, face à face solennel avec le Grand
âge, évoquent les rendez-vous d’une âme avec l’échéance
d’une vie, à l’approche sereine de la mort. C’est cette œuvre
que le Prix Nobel viendra couronner en 1960, l’année de sa
publication. Son discours prononcé à Stockholm est publié sous le
titre Poésie.
« …
Grand âge, nous voici – et nos pas d’hommes vers l’issue.
C’est assez d’engranger, il est temps d’éventer et d’honorer
notre aire.
« Ah !
qu’une élite aussi se lève, de très grands arbres sur la terre,
comme tribu de grandes âmes et qui nous tiennent en leur conseil…
Et la sévérité du soir descende, avec l’aveu de sa douceur, sur
les chemins de pierre brûlante éclairés de lavande…
« Et
nos actes s’éloignent dans leurs vergers d’éclairs…
« À
d’autres d’édifier, parmi les schistes et les laves. À d’autres
de lever les marbres à la ville.
In
Chronique,
VIII, ibid.
p. 403
 Saint-John
Perse, qui a toujours refusé tout poème de circonstance, accepte
toutefois, pour les 80 ans de Georges Braque, d’accompagner de ses
textes, en 1962, une série de 12 eaux-fortes originales du peintre
sur le thème de l’oiseau. Un thème particulièrement cher au
poète, féru d’ornithologie. L’oiseau étant à ses yeux le
symbole de l’élévation, et d’une exhortation au dépassement
perpétuel. En 1963 ses textes sont réunis dans Oiseaux,
publié chez
Gallimard.
Saint-John
Perse, qui a toujours refusé tout poème de circonstance, accepte
toutefois, pour les 80 ans de Georges Braque, d’accompagner de ses
textes, en 1962, une série de 12 eaux-fortes originales du peintre
sur le thème de l’oiseau. Un thème particulièrement cher au
poète, féru d’ornithologie. L’oiseau étant à ses yeux le
symbole de l’élévation, et d’une exhortation au dépassement
perpétuel. En 1963 ses textes sont réunis dans Oiseaux,
publié chez
Gallimard.
Au
point d’hypnose d’un œil immense habité par le peintre, comme
l’œil même du cyclone en course – toutes choses rapportées à
leurs causes lointaines et tous feux se croisant – c’est l’unité
enfin renouée et le divers réconcilié. Après telle et si longue
consommation du vol, c’est la grande ronde d’oiseaux peints sur
la roue zodiacale, et le rassemblement d’une famille entière
d’ailes dans le vent jaune, comme une seule et vaste hélice en
quête de ses pales.
Et
parce qu’ils cherchent l’affinité, en ce non-lieu très sûr et
très vertigineux, comme en un point focal où l’œil d’un Braque
cherche la fusion des éléments, il leur arrive de mimer là quelque
nageoire sous-marine, quelque aileron de flamme vive ou quelque
couple de feuilles au vent.
Ou
bien les voici, dans tout ce haut suspens, comme graines ailées,
samares géantes et semences d’érables : oiseaux semés au
vent d’une aube, ils ensemencent à long terme nos sites et nos
jours…
In
Oiseaux, XI,
ibid. p.
422-423
Chant
pour un équinoxe,
publié en 1971, sera
le dernier recueil du poète, qui consacre désormais tout son temps
à la publication du volume de ses œuvres complètes, qui paraîtra
dans La Pléiade en 1972.
Saint
John Perse, mort en 1975, est enterré dans la presqu’île de
Giens, et sur sa tombe ne figure que le nom de plume de celui qui
s’est octroyé le statut d’ « étranger sans nom ni face »,
comme il est dit dans Chronique
(p. 394), « laissant à son œuvre le soin de refléter ses
mille visages de vivant », comme l’écrit Mireille Sacotte
(revue Europe, p. 142).
Éloignée
de toute forme de tristesse ou de nostalgie, la poésie de Saint-John
Perse exprime la louange et la célébration, la joie et la
délectation. Réputé obscur, parce qu’il a le souci de
l’exactitude des mots, il tend vers une perfection originelle du
langage. Sa langue, riche et précise, au vocabulaire rare et souvent
technique, témoigne de sa connaissance passionnée des métiers et
des registres de haute tradition, comme notamment ceux des
navigateurs, des cavaliers ou des botanistes, dont il utilise
volontiers les lexiques spécialisés.
Sans
se soucier d’érudition, ni de savoir encyclopédique, il
recherche inlassablement les instruments qui donnent le pouvoir de
nommer, pouvoir dont l’homme a jadis été dessaisi. Sa poésie est
celle de la nomination, car c’est le mot qui ouvre à l’infini
l’imaginaire. Il rêve d’une langue première, comme ces langues
insulaires, maorie ou caraïbe, dont il apprécie la douceur, proche
du souffle originel, et dont le langage poétique se propose de
recréer le rythme.
D’aucuns
se laissent rebuter par son style, le volume et la puissance de sa
phrase, qu’ils jugent déclamatoire. Le verset de Saint-John Perse
n’est pas un vers libre. Son unité de base est l’alexandrin
classique, subdivisé en autant de séquences différentes. Un vers
qui résonne amplement dans le souffle qui l’anime au cœur d’une
vaste fresque épique.
Une
poésie à contre-courant de son temps, en quête de l’énergie
spirituelle qu’elle recherche dans le désert, dans le vent, la mer
ou les oiseaux.
Bibliographie
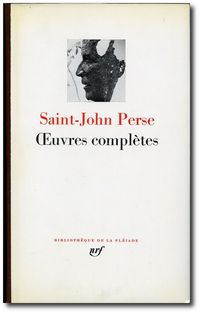
-
Éloges,
suivi de La
Gloire des Rois, Anabase, Exil,
© Poésie/Gallimard, 1967
-
Vents,
suivi de
Chronique et
de Chant
pour un équinoxe,
© Poésie/Gallimard, 1968
-
Amers,
suivi de
Oiseaux et
de Poésie,
© Poésie/Gallimard,
1970
-
Saint-John
Perse, Œuvres Complètes, La Pléiade, © Gallimard, 1972 / édition
augmentée 1982
Sur
l’auteur
-
Alain
Bosquet, Saint-John Perse, coll. Poètes d’aujourd’hui, ©
Seghers, 1953 / rééd. 1959
-
Mireille
Sacotte, Saint-John Perse, © Belfond, 1991 / © L’Harmattan, 1997
-
Dossier
Saint-John Perse, revue Europe, n° 799-800, nov-déc. 1995
-
Roger
Caillois / Saint-John Perse, Correspondance,
1942-1975,
Cahiers
Saint-John Perse, n°
13, © Gallimard, 1996
-
Saint-John
Perse, Lettres
à une dame d’Amérique, Mina Curtiss, 1951-1973,
traduit et présenté par Mireille Sacotte, Cahiers
Saint-John Perse, n°
16, © Gallimard, 2003
-
Renaud
Meltz, Alexis
Leger dit Saint-John Perse, © Flammarion,
2008
-
Renée
Ventresque, La
« Pléiade » de Saint-John Perse, La poésie contre
l’histoire, © Garnier,
2011
Internet
Contribution
de Jacques
Décréau