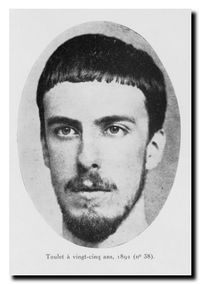 Victor Hugo était un chêne,
Victor Hugo était un chêne,
Alphonse de Lamartine un saule pleureur,
Francis James un épi de blé,
François Villon un nénuphar de caniveau…
Paul-Jean Toulet, lui, est une espèce de fleur de serre poussée par hasard sur le bord d’un balcon mousseux au carrefour d’un sentier du Béarn et d’un boulevard parisien.
Doit-on à tout prix chercher à comprendre l’incompréhensible ?
Il ne s’appelait d’ailleurs pas Paul-Jean. Son réel prénom n’était que Paul…
Paul.
Toulet.
Mais, passé son baccalauréat, songeant déjà au futur, peut-être à sa conquête de gloire et de fortune, pensant que ses initiales feraient éclater de rire le Tout-Paris, le tout Univers et lui porteraient tort, il intercala un Jean entre son nom et son prénom.
C’est ce qu’on appelle avoir le sens du ridicule.
Son semblant de notoriété tardive, de son vivant, et sa presque notoriété posthume y trouveront leur compte. Je dis « semblant » et « presque », mais plus subtile est l’exacte vérité… car si Toulet n’appartient pas au nombre des étoiles universelles, de ceux qui ont bouleversé le domaine poétique, ceux qui forment le cortège des monstres, si on ne le remarque pas immédiatement… peu à peu, insidieusement, certains de ses vers s’infiltrent, s’imposent à notre cœur, à notre réflexion, à notre mémoire et ne nous quittent plus. Alors nous revenons sur nos pas, nous relisons… relisons…
et sa poésie à voix basse fait désormais partie de nous…
de vous…
de moi…
En fait il nous fait le coup de l’inconnu célèbre.
Je dirais que la destinée de son œuvre est un peu semblable, en littérature romanesque, à celle d’Alexandre Vialatte, c’est au deuxième ou troisième abordage que ces gens-là nous réduisent à merci. On oublie difficilement…
« L’homme est un animal à chapeau mou qui attend l’autobus 27 au coin de la rue de la Glacière. »
… De même que, de Paul-Jean Toulet, on oublie difficilement…
Une lueur tranchante et mince
Échancre mon plafond.
Très loin, sur le pavé profond,
J’entends un seau qui grince…
… Encore faut-il saisir le vers au vol, saisir le climat de Toulet, se fondre en lui… C’est là qu’est tout le problème de son rapport au grand public.
Problème…
Cette œuvre poétique, en fait totalement autobiographique, brève puisqu’elle tient toute entière en à peu près cent cinquante pages, implique sans réserve l’intelligence du lecteur.
Je veux dire par là, quitte à me faire traiter d’imbécile, d’inconscient, ce dont je me fous, voire de me faire lapider, ce qui m’amuse moins, que Victor Hugo, par exemple, plaît aux amateurs éclairés comme aux ignorants et aux butors pour qui le sérieux dramatique est un label de qualité. Hugo, c’est un poids lourd à pneus larges qui emballe et emporte avec lui l’intelligence et son contraire. Comme Verdi dans le domaine de l’opéra. Encore par là je veux dire que Toulet ne peut pas plaire à tous les publics, car pour l’apprécier, en dehors des tournures de phrase et des ellipses qu’il faut maîtriser, l’intelligence est obligatoire, et pas n’importe quelle intelligence !… , celle qui comprend la légèreté, la dérision, l’ironie, le rire, le recul, mêlés à la mélancolie et à la nostalgie. Une association de goûts qui n’est pas à la portée du premier venu.
Le sonneur se suspend, s’élance,
Perd pied contre le mur,
Et monte : on dirait un fruit mûr
Que la branche balance.
Une fille passe. Elle rit
De tout son frais visage :
L’hiver de ce noir paysage
A-t-il soudain fleuri ?
Je vois briller encor sa face,
Quand elle prend le coin.
L’Angélus et sa jupe, au loin,
L’un et l’autre, s’efface.
Ce poème ?… C’est un clin d’œil, un croquis, une aquarelle dans les bleus pâles, balancée en deux coups de pinceau précis… Car tout y est précis, concis, le mot comme la ponctuation, pas un ne manque, pas un trop. On pense à la rigueur et à la précision d’un La Fontaine dans ses meilleures fables. On commence par le rire devant le balancement comique des sonneurs des anciennes églises suspendus aux cordes de leurs cloches, puis c’est la gaieté tendre qui passe avec le pas de la petite gonzesse, et la fin dans un vague brouillard de blues… Ça me fait penser aux derniers vers de la chanson Le parapluie de Georges Brassens…
« … Il a fallu qu’elle me quitte
Après m’avoir dit grand merci,
Et je l’ai vue, toute petite,
Partir gaiement vers mon oubli… »
Écoutez encore…
L’hiver bat la vitre et le toit,
Il fait bon dans la chambre,
À part cette sale odeur d’ambre
Et de plaisir. Mais toi,
Les roses naissent sur ta face
Quand tu ris près du feu…
Ce soir tu me diras adieu,
Ombre que l’ombre efface.
Sourire et mélancolie.
Frémissement des sentiments.
Sensualité à fleur de peau.
Prince de la grammaire, grand-duc de la technique d’écriture, Toulet n’étale jamais son savoir, il le met constamment au service du sentiment, tout comme il ne se complet pas dans l’étalage dramatique, mais, au contraire, préserve une continuelle pudeur. À l’opposé du nouveau riche de la culture.
Et à l’opposé du nouveau riche tout court durant toute sa vie.
Mais justement j’y viens, à sa vie.
*********
Paul-Jean Toulet était né à Pau un 5 juin 1867, au numéro 16 de la rue d’Orléans. Une sœur, Jane, l’avait précédé.
Gaston, le père, béarnais, est planteur à l’île Maurice comme le père de sa moitié, la créole Marie-Emma, ils ont quitté l’île, en compagnie de la mère de la jeune femme, pour que l’enfant naisse en France.
La grand-mère meurt durant la traversée.
Emma, elle, épuisée par le voyage, les couches et la disparition de sa mère, décède le 19 juin 1867, deux semaines après la naissance.
Paul-Jean ne parlera jamais de cette maman qu’il n’a pas connue, mais dont l’absence l’habitera, me semble-t-il, continuellement… Une vieille servante, Louise, après la mort du poète, se souvenait que l’enfant écrivait sur des bouts de papier, « Ici repose Emma Toulet, morte peu de jours après la naissance du petit Paul ». Et elle répétait « Le pauvre enfant… Le pauvre enfant… » Une autre se souvenait de sa tristesse, d’une espèce de hantise, quand il pensait à sa mère.
Ce n’est pas anodin.
La précarité de sa santé, vite révélée, le poursuivra toute sa vie jusqu’à l’abattre, servie magnifiquement, il faut bien le dire, par la houle de son existence.
Le père s’en retourne à l’île Maurice où il se remariera une dizaine d’années plus tard, en 1878, avec une jeune fille de dix-neuf ans, nièce d’Emma, qui lui donnera sept fils.
De cet homme, Paul-Jean écrira…
« Je ne sais trop de quoi il mourut… Mon enfance le connut peu, mon adolescence à peine d’avantage. Il était constamment hors de chez lui, occupé d’agriculture, de politique, d’affaire, de mille choses inutiles et coûteuses. »
C’est la sœur de son père, Amanda, qui à dix-huit ans devient sa mère de remplacement, bientôt mariée à Jacques Terlé, militaire et officier. Ils vivent à Billières, qu’il écrit « Bilhères » à l’anglaise, dans une demeure à quelques mètres de Pau.
« Sur mes six ans… je demeurais dans une petite villa de Bilhère, et de là, chaque matin à la belle saison, je gagnais Pau et l’école des Dominicaines, où me conduisait mon oncle, en se rendant lui-même au Quartier. Il ne faisait encore que petit jour ; du brouillard pendait entre nous et les montagnes. Sur les giroflées qui habitent le creux des murs, sur les fleurs sanglantes, au bord des allées de gazon, la rosée avait laissé de belles larmes ; et mon oncle cueillait pour moi, parmi les larges feuilles, une grappe de raisin glacé »
Et après…
« Souvent l’été, par la fenêtre d’en haut tournée au midi, de grand matin je regardais. D’abord adossées à l’horizon, les lointaines Pyrénées, d’un bleu tendre – immédiatement contre, le parc de Pau, cachant les plans intermédiaires de la colline aux sombres feuillages – et enfin notre jardin, éveillé par le soleil levant, plein de bourdonnements, de parfums, avec ses poiriers symétriques, ses allées de gazon, et sous moi une tonnelle de glycine aux fortes odeurs. Du côté gauche, la caserne envoyant parfois un chant de clairon. »
On passe par une petite rue et on se trouve devant un gros pavé percé d’ouvertures dont n’émane pas une immense ambiance folichonne, c’est l’école. Salles de classe, couloirs, cour…
Et dans cette petite cour, une statue de Diane lui laissera l’un de ces souvenirs de rien qui imprègnent à jamais l’esprit des enfants…
Au détour de la rue étroite
S’ouvre l’ombre et la cour
Où Diane en plâtre, et qui court
N’a que la jambe droite.
C’est Paul-Jean qui lui a inventé un manque de jambe gauche. Pourquoi ?… Allez savoir… Les poètes sont de drôles de types, chantait Léo Ferré… À moins qu’il n’ait pratiqué cette amputation uniquement pour la rime à étroite, et pour la farce… Tout est possible.
Le village de Carresse est pour les vacances. Une maison que sa mère lui a léguée, le Haget, des arbres, des fleurs, un chemin qui descend au Gave, et où se retrouve toute la famille y compris sa sœur Jane qui est  élevée à l’entour de Bordeaux.
élevée à l’entour de Bordeaux.
Vacances… Vacances. Vacances…
« Je regretterai toute ma vie les terres de famille qu’il m’a fallu vendre. Il y avait des bouquets d’arbres et des familles de serviteurs qui nous appartenaient depuis des siècles. On ne s’en détache pas sans un peu de mélancolie. »
Et c’est, après les Dominicaines et sa première communion dans l’église de Carresse, la rentrée au collège de Pau en 1878.
Après quelques semaines chez le frère de son père, Adrien Toulet, qui rejoint l’île Maurice, le jeune gamin de onze ans se retrouve parmi les pensionnaires du collège. Pour lui, délicat, fragile, hypersensible, élevé jusque là dans les jardins fleuris, la bonne éducation familiale et dominicaine, le changement est violent.
Un extrait de son roman « Monsieur du Paur, homme public » donne une idée de son mépris de l’internat…
« Songez à l’horrible collège, aux camarades qui ne se lavent pas, qui mentent pour éviter les punitions, qui jurent par bravade et se font gloire d’être débraillés et discourtois. Songez aux pions qui les valent, ou plutôt qui ne les valent pas, ratés qui ont fini de bien faire, qui ne trouveraient pas à s’employer comme clercs d’huissiers ou goujats de gargote, et auxquels on confie l’âme des enfants, je pense, pour s’y essuyer les pieds. Ajoutez à tout cela le proviseur patelin, une cuisine à tourner le cœur, le dortoir où l’on manque d’air… »
Une autre de ses contre rimes retourne à cette enfance…
Les tambours du Morne Maudit
Battant sous les étoiles
Et la flamme où pendaient nos toiles
D’un éternel midi ;
Rêves d’enfant, voix de la neige,
Et vous, murs où la nuit
Tournait avec mon jeune ennui…
Collège, noir manège.
Jusqu’à quatorze ans ou presque, le jeune Toulet s’impose comme un élève studieux, brillant, discipliné, qui collectionne les prix de fin d’année, les félicitations et les applaudissements.
Il déteste l’école, il l’a toujours détestée, mais plusieurs années durant il donnera le change.
Et puis un jour…
le raz le bol l’emporte sur le reste…
il n’en peut plus.
Il veut sans délai abandonner cette auge…
Sans délai !
Il dérape, devient le semeur de troubles… l’organisateur de pagaille, l’insupportable invivable de service… Plusieurs mois… Plusieurs mois… Jusqu’à l’instant où il glisse un encrier dans le chapeau d’un pion. L’encre n’étant pas un matériau transparent et volatile, on imagine le résultat.
Renvoi immédiat.
Satisfaction du condamné.
La famille, elle, n’apprécie pas trop.
Paul-Jean espérait, suite à ce coup d’éclat, être expédié à l’île Maurice, dont il rêve. Il est simplement envoyé au lycée de Bayonne, sous la protection de son oncle Eugène Dabadie, officier d’artillerie marié à sa tante Louise. Mais son attitude est tellement insolente qu’en quelques heures il est à nouveau renvoyé.
Il prend un rien de bon temps à travers Bayonne.
Puis c’est l’institut Charlemagne.
Encore viré. Mais repris.
Désormais il reloge chez son oncle Jacques Terlé, toujours officier, mais cette fois-ci à Saintes.
« J’étais censé faire ma philosophie et le collège de Saintes est le seul d’où je n’ai pas été mis à la porte… »
Pensionnaire libre, très libre, il flâne, papillonne, reprend toutefois ses études en mains, à peu près, et à la fin de l’année scolaire 1885, peut se vanter d’avoir obtenu ses deux bacs et connu certaines aventures féminines, déjà. C’est plus qu’un jeune homme, c’est un jeune faune envoûté par le sexe féminin, ce qu’il restera durant sa vie entière. Il a aussi fait paraître son premier article le 7 mai 1885 dans « Le Phare des Charentes » à propos d’une exposition de peinture, grâce à l’absence d’un ami responsable de cette chronique.
Débarrassé de ses soucis scolaires, il s’empresse de courir à Carresse…
Le tournebroche à poids qui réglait la cuisine
S’est tu, comme le dur et noir magnolier
Où grimpait en chantant ma petite voisine.
L’ombre des cyprès tourne. Est-ce pour oublier ?
… puis à Cauterets où, en plus des femmes en cascade il commence à sérieusement jouer au casino, perdre et s’y perdre, puis encore au château de la Rafette, propriété d’Aristide Chaline et Amélie, sœur d’Emma, qui avaient acheté ce domaine en 1877. Et dont il est un habitué…
Les colombes de ma cousine
Pleurent comme une enfant.
Le dindon roue en s’esclaffant :
Il court à la cuisine.
Contre rime ? La succession des huit pieds-six pieds, huit pieds-six pieds, la rime jouant de huit à huit et de six à six, ou autrement suivant l’humeur de l’auteur.
Presque de petits clichés, instantanés poétiquement photographiés au vol… Celui-ci… ou encore celui-là…
Ces gammes de tes doigts hardis,
C’était déjà des gammes
Quand n’étaient pas encor des dames
Mes cousines, jadis ;
Et qu’aux toits noirs de la Rafette,
où grince un fer changeant,
Les abeilles d’or et d’argent
Mettaient l’aurore en fête.
La manière qu’il a de faire se chevaucher les sonorités en agençant les mots de telle façon qu’ils s’entrechoquent, parfois même donnent l’impression de s’opposer tout en gardant l’unité du propos, et de faire scintiller les images… ça n’en finit pas de me ravir et de me sidérer… Pas vous ?… Non ?… Mais si !… Bien sûr que si !
Malheureusement sa fragilité le rattrape.
Tuberculose pulmonaire.
La santé n’a jamais été brillante, mais maintenant elle semble l’être encore moins. Le diagnostic médical est sans appel. Il lui faut de la chaleur, encore de la chaleur, toujours de la chaleur. Et cette santé flageolante lui offre enfin ce qu’il espère nuit et jour depuis bien longtemps, son départ pour l’île Maurice.
Il y fera certainement chaud.
Un dernier tour de nénettes, de boissons, de tapis vert, et salut tout le monde, à moi les mille huit cent soixante-cinq kilomètres carrés de cette terre qui trône dans l’océan indien !!… Ne bouge pas, commence à dégrafer ta robe, j’arrive !!
*********
Après un voyage d’une banalité décevante, entre novembre 1885 et octobre 1888 Paul-Jean Toulet s’ébroue à travers l’île Maurice.
Il ne travaille pas, son père le laisse faire, ou plutôt ne rien faire, il lit, n’écrit presque pas, joue et fait l’amour, c’est tout… Non ! ce n’est pas tout !… C’est à Maurice qu’il découvre la drogue. Le 9 mai 1885, sortant de l’église, il achète de la ganja, une drogue « de la région ». C’est le début d’un chemin qui le mènera vite à l’opium, au laudanum et à l’éther d’ici quelques années.
En attendant ce futur, il s’occupe sous le soleil à travers les plages, sous les arbres, les varangues, et sur les corps des filles…
Molle rive dont le dessin
Est d’un bras qui se plie,
Colline de brume embellie
Comme se voile un sein,
Filaos au chantant ramage –
Que je meure et, demain,
Vous ne serez plus, si ma main
N’a fixé votre image.
Il n’est pas inutile de préciser, pour éviter un tripatouillage de dictionnaire, qu’une varangue est une véranda, et qu’un filao est un arbre superbe dont la présence est fréquente sur cette île… quel beau mariage que celui de la nature et de l’amour !…
Douce plage où naquit mon âme ;
Et toi, savane en fleurs
Que l’océan trempe de pleurs
Et le soleil de flammes ;
Douce aux ramiers, douce aux amants,
Toi de qui la ramure
Nous charmait d’ombre, et de murmure,
Et de roucoulements ;
Où j’écoute frémir encore
Un aveu tendre et fier –
Tandis qu’au loin riait la mer
Sur le corail sonore.
Pendant trois années, donc, rien ou presque rien
Femmes de salons ou femmes de chambre, tout est bon pour le chasseur. Il faudra pourtant qu’il fasse attention à ne pas « faire ça » avec une de ses demi-sœurs, car il en a beaucoup, semble-t-il, à Maurice où son père a largement œuvré. Mais généralement il est prévenu à temps.
Ne prenez pas cet air pointu
En parlant d’amour ancillaire.
Achille a taxé sa vertu
Au prix des captives, ma chère.
Et je sais, brûlé d’autres cieux,
Un village sous les goyaves,
Peuplé des fils par mes aïeux l’image
Qu’ils avaient fait à leurs esclaves.
Cependant je n’ai pas dit qu’il n’écrivait « pas », j’ai dit « presque pas », ce n’est pas pareil. En 1887, environ, il a donc juste vingt ans, il jette certaines esquisses sur le papier…
Au pays du sucre et des mangues,
Les pâles dames créoles
S’éventent sous les varangues
Au pays du sucre et des mangues
Et zézaient de lentes paroles.
Dans les grands fauteuils balançoires
En sombre bois des îles
Elles content de vaines histoires
Dans les grands fauteuils balançoires
Qui bercent leurs têtes futiles.
Ainsi qu’une odeur de parterre
Lointaine et paresseuse,
Dans leur cœur s’infiltre en mystère
Ainsi qu’une odeur de parterre
Leur grâce voluptueuse.
L’état d’esprit est là.
Trois années de Maurice.
Trois années de fiesta.
Et puis, peut-être un peu las de ce trop de facilité, plein de chairs et de ganja, il décide de reprendre ses études et penche pour le droit. Ce sera en Algérie, dont un médecin lui a recommandé le climat, pour ses poumons.
Il quitte Maurice dont il gardera de précieux souvenirs mêlés de paysages magnifiques et de sensualité amoureuse… Il vénère les paysages…
Jardin qu’un dieu sans doute a posé sur les eaux,
Maurice, où la mer chante, et dorment les oiseaux.
Et, plus précisément…
Dessous le flamboyant qui couvre l’herbe nue
D’un dôme violet, où je vous vois encor
Fraîche comme l’eau vive en un brûlant décor,
Jeanne aux yeux ténébreux, qu’êtes-vous devenue ?
Du pont de son navire il voit s’éloigner cette île où il ne reviendra jamais. Un chapitre prend fin. Celui qui va s’ouvrir ne va pas être tout simple.
*********
Alger, ville d’amour, où tant de nuits passées
M’ont fait voir le henné de tes roses talons,
Tu nourrissais pour moi, d’une vierge aux doigts longs,
L’amour, et l’esclavage, et les fureurs glacées.
Comme certains passent par la Lorraine avec leurs sabots, Paul-Jean Toulet passe par l’Égypte avec sa pyramide… il aura en effet escaladé celle de Khéops à en crever d’essoufflement… et débarque à Alger le 3 décembre 1888.
Une pension versée par son père lui permet d’envisager sereinement son séjour.
Il changera fréquemment de logement, se fera quelques amis. Peu, d’ailleurs, bien qu’assez social, car le personnage est dérangeant… il a tout du fils de famille désinvolte au visage d’ascète « qui ne se mêle pas à n’importe qui », ses phrases sont brèves, entrecoupées de silences, son attitude distante, son rire peu fréquent, sec, son regard intense, son expression verbale recherchée, particulière… bref le genre de personnage que détestent tous ceux qui ont la familiarité facile, vous tapent sur le ventre… sans compter ceux qui n’aiment pas les snobs ou l’apparence du snobisme.
Mais alors qu’il n’avait rien fait à Maurice, il va travailler intensément à Alger, bien qu’ayant vite abandonné ses études de droit et un début d’études littéraires. Il participe à l’écriture de deux pièces de théâtre qui sont jouées, collabore régulièrement à plusieurs journaux à la fois, articles et chroniques historiques, écrit une nouvelle, des vers…
Derrière les rideaux des fenêtres closes
Tes yeux rient et la nacre de ta pâleur
Et l’or de la chambre où naguère est éclose
Notre amour ainsi qu’une fleur.
Nous oublierons la rue aux voix étrangères
La blanche cité vide excepté de nous ;
L’heure est pleine de rêve et d’ailes légères,
J’ai mis mon front sur tes genoux.
En plus des travaux accumulés, les aventures charnelles suivent les aventures charnelles, comme toujours avec Paul-Jean… Mais vient le jour où il tombe sur un bec.
Marguerite.
Nattes noires en chignon, œil étiré, pers, cils épais, démarche de reine, silhouette féline, Marguerite travaille dans un atelier de couture. Elle est loin d’être une oie blanche. Elle a déjà épinglé de nombreux hommes. Le conquérant est conquis. Il tombe profondément amoureux, elle joue de son corps, de son cœur, s’allonge avec d’autres hommes, il le sait, il est désespéré. Il gardera une blessure profonde de cette liaison et de sa rupture.
J’évoque sur tes bords heureux,
O Méditerranée,
D’une amoureuse après-dînée
L’ombre, le rocher creux.
Ou ce vestige périssable
Et trop vite effacé
Qu’en témoignage avaient tracé
Ses hanches dans le sable.
Peut-être est-ce à cette Marguerite qu’on doit, en partie seulement, car elle était déjà en lui, l’ironie mélancolique et désabusée qui baigne son œuvre.
19 novembre 1889, adieu Alger !
Il retourne en ce natal Béarn auquel il appartient viscéralement.
*********
Paul-Jean Toulet va passer presque dix années à se la douce couler en sa propriété du Haget, à Carresse, qui est comprise dans son héritage.
Des années de bamboche
Il est jeune. Il est bel homme. Il est sensuel. Héritier aussi d’une certaine nonchalance créole. Il est riche, reçoit beaucoup, boit beaucoup, se drogue, joue beaucoup, notamment au casino de Salies-de-Béarn… Il aime beaucoup, bourgeoises, femmes du monde ou petites vénales. Il se lève tard, se couche tard, s’habille magnifiquement. C’est un dandy qui se fait adorer ou détester. Il lit énormément, et il écrit, mais aucun de ses amis ne le sait. Lorsque, plus tard, ils apprendront la publication de son premier roman, comme pris à revers, ils n’en reviendront pas, n’ayant toujours vu en lui qu’un noceur, un bambocheur ironique et cultivé. Régulièrement, quand il est las de la tranquillité de Carresse il va prendre l’air de la ville à Pau pour un ou deux jours… qui se transforment en deux ou trois semaines.
Il arrive sans le moindre bagage…
loue une chambre en ville ou dans l’un des deux palaces, le Gassion ou l’Hôtel du Parc…
va quotidiennement acheter de quoi se vêtir, chemises, vêtements, sous – vêtements, de quoi se chausser, ainsi que des masses de livres, qui s’éparpillent, s’entassent dans tous les coins de sa chambre, où règne une fabuleuse pagaille, dont il ne sort, ou dont des amis ne viennent le sortir, qu’en milieu d’après-midi pour s’installer à la terrasse du café Champagne en compagnie de son cercle d’amis.
C’est à cette terrasse qu’il fait la connaissance de Francis Jammes, déjà célèbre et encensé, qui, après la mort de Paul-Jean, se souviendra de lui, de ce lieu et de ce jour…
 « Toulet maigre et long est assis, jambes croisées, les pieds dans des sandales blanches, les mains jointes enserrant son genou droit. Il est tellement replié sur lui-même qu’il a l’air bossu et que son estomac s’appuie sur le genou que j’ai dit.
« Toulet maigre et long est assis, jambes croisées, les pieds dans des sandales blanches, les mains jointes enserrant son genou droit. Il est tellement replié sur lui-même qu’il a l’air bossu et que son estomac s’appuie sur le genou que j’ai dit.
Cependant, par un effort en sens contraire, sa tête se relève, la barbiche blonde apparaît, comme d’un serpent conventionnel dans une fable. Et, peu à peu, ses gros yeux bleus de jeune fille vous fixent de sous l’étroit béret basque rabattu sur le front. La lèvre, d’une minceur extrême, se crispe. Il sourit, m’invite à m’asseoir devant son absinthe. Il sort du lit. Il est cinq heures de l’après-midi. C’est être, pour lui, matinal.
Il est gentil. Il me parle de mes vers. Il n’écrit pas, ou, du moins, ne les produit pas encore. Nous avons quelque vingt-six ans chacun… »
« Toulet fut un grammairien, mais un grammairien de génie. J’en appelle à la savante et brève structure de sa strophe, à la souplesse de sa syntaxe, en vers et en prose, à des raccourcis qui révèlent une haute culture classique, à la sobriété qui intensifie chez lui la sensation, prolonge le charme parfois trop licencieux d’un esprit du dix-septième siècle, à la sonorité de cristal de son clavecin. Car Toulet jour du clavecin, mais il en joue comme Mozart. »
Que choisir de mieux pour illustrer ces mots, sinon cette splendeur qu’est « En Arles » ?… À ce propos, savez-vous qu’en Arles, les Aliscams sont les voies bordées de tombeaux romains ?… et savez-vous à quel point un poète peut prendre des libertés avec l’orthographe ?… Mais vous le saviez, suis-je bête !… Faites comme si je n’avais rien dit…
Dans Arles, où sont les Aliscams
Quand l’ombre est rouge sous les roses,
Et clair le temps,
Prends garde à la douceur des choses.
Lorsque tu sens battre sans cause
Ton cœur trop lourd ;
Et que se taisent les colombes :
Parle tout bas, si c’est d’amour,
Au bord des tombes.
… Ce qui me fait penser tout de suite à ces deux autres vers… qu’il avait enfantés… avant… ou après…
Il n’est plus, ce jour bleu – ni ses blanches colombes –
Ce jour brûlant, où tu m’aimas parmi les tombes.
Si vous n’aimez pas ça je ne peux plus rien pour vous et je vous conseille le suicide pour abréger vos souffrances… Et si j’ai cité un long passage de Francis Jammes, le poète qui a écrit ce chef-d’œuvre d’émotion qu’est sa prière pour aller au paradis avec les ânes, c’est parce que sa vision de Toulet tant physique qu’artistique est d’une justesse étourdissante.
Sans compter que, sans le vouloir, ce passage semble me reprocher de ne pas avoir encore parlé du béret basque de Paul-Jean. Un béret qu’il quittait peu souvent, comme une affirmation sociale de sa personnalité béarnaise. Nombre de photos en témoignent. J’ai parfois des oublis de ce genre, il faut m’en excuser.
Deux courts voyages s’intercalent entre ces années béarnaises. Juste deux. L’un en Espagne…
J’ai connu dans Séville, une enfant brune et tendre
Nous n’eûmes aucun mal, hélas, à nous entendre.
L’autre à Paris…
Sur le canal Saint-Martin glisse,
Lisse et peinte comme un joujou,
Une péniche en acajou,
Avec ses volets à coulisse,
Un caillebots au minium,
Et deux pots de géranium
Pour la Picarde, en bas, qui drôle.
Quand il quitte Pau, comme pour venir il ne s’encombre d’aucun bagage. L’hôtelier sera bon, si ça lui chante, pour expédier habillement et bouquins à Carresse.
Inutile de préciser qu’à ce train l’argent file et file droit.
À la fin il n’y en a plus.
Toulet doit vendre le Haget.
Il voudrait être un professionnel de l’écriture ?… depuis déjà un bail ? Mais, encore Ferré… qui vivent de leur plume, ou qui n’en vivent pas, c’est selon la saison…
Il n’a publié qu’une nouvelle durant cette longue période, « Un serf », dans une revue.
De toute façon, qu’on en vive, qu’on en survive, qu’on en meurt, c’est à Paris que tout se joue…
Alors…
1898…
Allons-y, on verra bien… J’ai du talent, quoi !
**********
 Toulet, pense-t-on, avait rencontré Curnonsky à Pau. À Paris les deux hommes se retrouvent et, inséparables, vont former un couple célèbre dans le milieu littéraire et journalistique.
Toulet, pense-t-on, avait rencontré Curnonsky à Pau. À Paris les deux hommes se retrouvent et, inséparables, vont former un couple célèbre dans le milieu littéraire et journalistique.
C’est un nom, ça, Cur-non-sky ?
Non… Il s’appelle en réalité Maurice-Edmond Sailland, né à Angers le 12 octobre 1872. C’est Alphonse Allais qui lui a dégoté son nom de bataille, « cur » et « non », termes latins qui se traduisent par « pourquoi pas », auxquels s’ajoute « sky » en hommage à la Russie dont on parle beaucoup alors. Voilà, il suffisait d’y penser. Surnommé Curne ou Khurne, comme Paul-Jean il dévore les livres. Un début d’études de lettres laisse la place au journalisme et à la littérature culinaires dont il deviendra le grand prêtre international et l’une des légendes.
Curnonsky est gros.
Toulet, maigre.
Curnonsky a un appétit d’ogre.
Toulet picore.
Curnonsky est jovial, constamment dans la rigolade.
Toulet, ironique, constamment dans le grincement.
Ils aiment la vie nocturne et les filles.
Ils ne se quittent pas.
Il ont chacun leur chambre, mais dans le même appartement qu’ils ont baptisé « Le Pavanatoire », 7 rue de Villersexel dans le septième arrondissement. Quelques saisons plus tard, ils habiteront 14 place de Laborde, devenue depuis place Henri Bergson, dans le huitième, mais là ils auront chacun leur étage.
Ils se lèvent en milieu d’après-midi.
Se couchent au petit jour.
Écrivent, seuls ou à deux.
C’est à deux qu’ils pondent plusieurs bouquins. Le bréviaire des Courtisanes et Le métier d’amant qu’ils avaient décidé de signer Perdican, seront signés Perdiccas à la suite d’une mauvaise communication téléphonique. Demi-veuve sera signé du seul Curnonsky, avec l’approbation de Toulet.
Au fil des années seront publiés plusieurs romans et nouvelles de Paul-Jean dont Monsieur du Paur, homme public, Les tendres ménages, La jeune fille verte, Le mariage de Don Quichotte, entre autres, et Mon Amie Nane qui compte de nombreux fanatiques, dont Jean d’Ormesson, mais qui, comme tous ses ouvrages romanesques ne rencontrera pas le succès.
« Les éditeurs prennent mes livres pour du vin, et les mettent à vieillir dans les caves, feuilletés sans doute par les spectres des catacombes, toutes choses qui vous expliqueront qu’aucun vivant n’en ai jamais lu. »
Mais sont-ils vraiment aboutis ?
Sa signature sillonnera divers journaux et revues… Il faut faire bouillir la marmite…
Et c’est le 25 juin 1910 qu’il publie pour la première fois une série de poèmes en forme de contre rimes dans « La Grande Revue ». Suivie, en novembre, d’une autre suite dans « Le Divan », revue dirigée par Henri Martineau qui deviendra un ami, un propagateur de son œuvre et son éditeur posthume.
Toulet sera aussi, toujours cette histoire de marmite, le nègre d’Henri Gauthier-Villars, dit Willy, dès 1908, comme l’auront été Curnonsky et Colette, pour sa série des « Claudine », dans une ambiance amicale malgré les heurts dus aux exigences pécuniaires de Paul-Jean, exigences au demeurant compréhensibles. Ces échanges épistolaires concernant les gros sous et les rédactions me font mourir de rire… Willy confie à Toulet des retouches de style, des corrections de passages importants, voire de chapitres complets…
« … Encore avez-vous le front de me reprocher mes retards ! Ne savez-vous plus écrire, oui ou non ? Voilà un mois que je vous demande ce qu’il faut faire avec mes deux tiers qui sont finis. Dans le doute, j’ai commencé l’autre tiers. Et comme vous auriez à la payer, si vous ne voulez pas que je continue, dites-le. Et expliquez-vous un peu clairement, que diable ! Ce n’est pas au-delà de vos forces… »
Il n’est en aucun cas question, pour moi, d’écrire une véritable biographie, mais de donner, en vrac, une suite d’éléments destinés à peindre, à expliquer, l’artiste Toulet… une sorte de kaléidoscope d’images vivantes…
J’ai bien dit en vrac ?…
De 1898 à 1912… Critiques de peinture, critiques littéraires, plus livret d’opéra, plus correspondance, notamment à lui-même qui nous vaut des minutes parfois étonnantes, plus romans, plus journal personnel, plus contes ou nouvelles, plus poésie, plus quoi encore ?…
C’est bien, le vrac, non ?…
En 1900 Paul-Jean Toulet est à Londres durant plusieurs jours, en visite chez Arthur Machen, auteur de « Le Grand Dieu Pan » qu’il doit traduire, et qui paraîtra en 1901. Cet écrivain, devenu célèbre à partir de 14-18 pour ses chroniques sur la guerre, est enthousiasmé par la traduction de Paul-Jean qui, intelligemment et dans un style exemplaire, a parfois plus adapté que traduit. Machen dira…
« Toulet me donna l’impression d’être un homme mélancolique, un homme pour qui le monde était un exil. »
Durant cet intermède anglais, Toulet, lui, écrit…
« Contemple un autre monde », a chuchoté la fée,
Cependant que les murs s’entr’ouvraient devant moi,
Découvrant Londres aux ombres d’or, son triste émoi,
Et la pendante Hécate, au ciel, sanglant trophée.
Et, plus gai…
À Londres je connus Bella,
Princesse moins lointaine
Que son mari le capitaine
Qui n’était jamais là.
Et peut-être aimait-il la mangue ;
Mais Bella, les français
Tels qu’on le parle : c’est assez
Pour qui ne prend que langue ;
Et la tienne vaut un talbin.
Mais quoi ? Rester rebelle,
Bella, quand te montre si belle
Le désordre du bain ?
Entre 1902 et 1903, après une escapade en Belgique, les deux écrituriens s’embarquent pour l’Indochine en vue d’un reportage tout à fait officiel sur l’exposition de Hanoï. Ils déborderont largement du cadre en poussant l’expédition jusqu’en Chine et au Japon.
Saigon : entre un ciel d’escarboucle
Et les flots incertains,
Du bruit, des gens de fièvre teints,
Sur le sanglant carboucle.
Et, seule où l’œil se recréât,
Pendait au toit d’un bouge
L’améthyste, dans tout se rouge,
d’un bougainvillée :
Tel aujourd’hui, sous la voilette,
Calice double et frais,
Mon regard vous boit à grands traits,
Beaux yeux de violette.
La soif d’opium ne le quitte pas, au contraire. Il en rapportera même un imposant stock en France…
Tout autour de la lampe à deux fois rallumée
Les papillons d’émail sont ivres de fumée.
Ou…
Brouillard de l’opium tout trempé d’indolence,
Robe d’or suspendue aux jardins du silence.
ou encore…
Boy, une pipe encor. Douce m’en soit l’aubaine
Et l’or aérien où s’étouffent les pas
Du sommeil. Mais non, reste, ô boy : n’entends-tu pas
Le dieu muet qui heurte à la porte d’ébène ?
De retour à Paris la vie reprend.
Écriture, drogue, alcool, jeu, virées nocturnes.
Toulet aime le théâtre, la danse, il côtoie de nombreux artistes, dont Léon Daudet, Maurras, Edmond Jaloux, Henri de Régnier, Émile Henriot, Jacques Boulenger, Caran d’Ache, et Claude Debussy, ce dernier très proche. Marcel Proust lui tape sur les nerfs, Lautrec lui a laissé un souvenir gêné…
« Toulouse-Lautrec est contrefait, trop court de jambes et s’exprime avec haine, entrecoupant son discours d’une espèce de « hein ? » plaintif et sauvage. »
Il fréquente le salon très couru d’Anna de Noailles et celui d’Augustine Bulteau qui le prend sous sa protection et tente, en vain, de le protéger de lui-même.
Il connaît un amour passionné avec Yvonne Vernon, splendide jeune femme d’un peu plus de vingt ans, sorte d’aventurière aventureuse qui a déjà fait le tour du monde, écrit remarquablement, et a été mariée au comte Sabini dont elle s’est séparée au bout de deux jours. Paul-Jean essaie de lui échapper, mais n’y parvient pas. Elle s’est elle-même donné le surnom de Noby. Ainsi l’appellera-t-il.
Quand je dis qu’il s’agit d’une passion, réciproque, je n’exagère pas…
« Mon amant
Je rentre, je suis comme grise : mon cœur bat dans le vertige du vide causé par votre absence. Je vous cherche partout dans l’appartement, et je sens mes lèvres se dessécher dans l’attente de votre baiser, et toute ma tendresse ardente s’épuiser, comme si vous ne la deviniez pas à travers la durée des heures jusqu’à demain, à travers ces cloisons de nuits qui s’épaississent jusqu’au dedans de moi-même ! Oh que je voudrais, pressée contre vous, perdre la notion de ma propre vie, comme mon corps se déforme lorsque uni étroitement au vôtre, il semble prolonger un identique plaisir.
J’éprouve, mon amant, un voluptueux frisson de honte, cette nuit, à me mettre nue, moralement, devant vous. Chaque mot que j’écris est comme une de vos caresses sur ma chair, et cela m’effeuille l’âme, lentement, douloureusement, impudiquement… Ah ! être tienne jusqu’en mes secrètes délices et mon infamie ! Je veux que tu saches combien loin de moi tu m’habites encore, et comment jusqu’à la froideur de ma nuit solitaire, ton souvenir me brûle les os !… »
Si, ça, ce n’est pas de la passion, dites-moi ce que c’est.
Toulet semble un peu dépassé par cette tornade amoureuse. Il n’est pas devant une cocotte, une petite pisseuse à prendre et à laisser, une mondaine délurée, une créature de passage. Il ne domine pas la situation parce qu’elle est son égale. Parce qu’elle est totalement libre dans son corps comme dans sa tête. Les engueulades, violentes, se succèdent comme les étreintes. Ils finissent par se séparer.
Il me semble, j’insiste sur le « Il me semble », en racontant Toulet, qu’en fait il n’a pas su aimer… Je m’explique, ou tout au moins j’essaie, ça n’engage que moi… Il n’a pas réellement compris l’amour. Il l’a espéré, mais n’a pas su, n’a pas pu, le saisir… parce qu’il en était incapable mentalement. Il me donne l’impression d’un baiseur, mais d’un coincé de l’union sentimentale. Je me demande si, dans son cas, le plaisir physique n’allait pas de pair avec une peur de l’amour avec un grand A. Je le sens verrouillé dans l’expression de son cœur devant une femme qu’il aime comme il est verrouillé dans la crispation de ses lèvres et de son corps qui se recroqueville jusqu’à se mettre en boule lorsqu’il est assis dans un fauteuil, sur une chaise ou un tabouret de bar ainsi que l’ont décrit tous ceux qui ont parlé de lui. Il s’envoyait les gonzesses, mais ne profitait pas des femmes, refusant qu’elles profitent de lui.
Peut-être a-t-il été, sentimentalement, son propre ennemi.
Peut-être n’a-t-il pas su se faire confiance aux bons moments et, incapable de se laisser aller, s’est-il autococufié.
Peut-être trop pudique, possédait-il trop le sens du ridicule et de l’autodérision…
Croyait-il profondément en ce qu’il était, en ce qu’il créait ?
Je me rappelle soudain qu’à Alger, en que tant journaliste, il avait traîné dans la boue sa propre pièce de théâtre. Dérision. J’aurais voulu voir la tête des comédiens à la lecture du papier.
Ça peut paralyser un homme, une intelligence pareille.
Je me trompe peut-être… Mais plus je l’observe plus cette impression s’impose à moi. J’ai connu deux ou trois personnages de ce genre, incapables d’ouvrir tranquillement la porte de l’amour. Coincés. Artisans précis de leurs catastrophes sentimentales.
Le Weber, rue Royale à deux pas de la Madeleine… Le Café de la Paix, place de l’Opéra… L’Élysée-Palace-Hôtel, au coin des Champs-Élysées et de la rue Bassano… Des bars hospitaliers où jusqu’à l’aube, et même après, le poète parle et dérive de verre en verre.
Trottoir de l’Élysée-Palace
Dans la nuit de velours
Où nos cœurs nous semblaient si lourds
Et notre chair si lasse ;
Dôme d’étoiles, noble toit,
Sur nos âmes brisées,
Taxautos des Champs-Elysées,
Soyez témoins ; et toi,
Sous-sol dont les vapeurs vineuses
Encensaient nos adieux –
Tandis que lui perlaient aux yeux
Ses larmes vénéneuses.
Là aussi, dans ce bar aux fauteuils de cuir rouge que Toulet a baptisé « Le Bain de Cuir », des artistes se retrouvent comme à un rendez-vous.
Tout continue.
Tout continue, oui, mais rien ne va vraiment plus.
On rit, on se baise, on déjeune…
Le soir tombe : on n’est plus très jeune.
Son escarcelle est vide, il doit une fortune à Curne, qui le voit moins, sa santé est dans un état lamentable.
En juillet 1912, sans donner d’explications, il quitte Paris pour ne plus y revenir et s’installe au château de La Rafette, chez sa sœur. 
**********
Il est malade.
Curnonsky ne donne aucun signe de vie, ne lui envoie pas le moindre mot.
Il est alité.
Il lit, quand il en a la force.
Sa famille l’entoure, le soigne.
1914. La guerre est là. En 1915 il essaie de s’engager. Refus, évidemment, étant donné ce qu’il est devenu, l’ombre de lui-même…
L’opium est désormais difficile à trouver, le laudanum et l’éther combleront les failles.
Mais je reviens à l’année 1910 pour quelques lignes puisqu’il s’agit d’un tout en vrac superposant les périodes.
Paul-Jean Toulet, alors, est encore à Paris et déjà physiquement en mauvaise posture. La drogue, la boisson et la vie en dérive ne pardonnent pas.
Et une sorte de coup de théâtre à lieu sur la scène de cette existence à vau-l’eau.
Une ancienne maîtresse, de la grande époque béarnaise, Marie Vergon, fille d’un hôtelier de Ghétary, toujours amoureuse de Paul-Jean et poussée par l’entourage provincial, débarque dans la capitale pour tenter de le maintenir à peu près droit. Elle est reçue par son ancien amant comme un chien dans un jeu de quilles. Mais elle reste.
Elle va s’occuper entièrement de lui. Soins, ménage, cuisine… et le soir va dormir dans une pension de famille. Lui, mufle, goujat comme on n’ose à peine imaginer, la présente à qui la croise comme sa servante. Ahurissant.
Mais la volonté, l’obstination de Marie, porteront leurs fruits.
Six années plus tard, le 12 juin 1916, elle épousera son monsieur.
Et Paul-Jean écrit à la femme de Claude Debussy une lettre hors du commun…
« … Je suppose que Claude lit les Communiqués, et j’espère que votre santé est devenue robuste.
La mienne pas du tout. J’ai été très malade pendant deux ans de plus, malade à ne pas écrire : pain. Puis j’ai été mieux et j’ai voulu m’engager (bourgeoisement, dans les Secrétariats). Mais ça n’a pas – comme disaient les gens frivoles avant la guerre – biché ; et j’ai eu une rechute. Sur quoi, ma famille fatiguée de me soigner, m’a marié : il y avait justement à la Rafette une façon de chapelle ou d’oratoire qui n’avait jamais servi à ça, et un père jésuite inoccupé
Tout le monde avait l’air satisfait ; il faisait un temps de juin bien agréable ; et les dames ont fort décemment pleuré au petit prêche de circonstance. Moi-même, malgré mon horreur des cérémonies, je n’aurais trop rien dit, si je n’eusse pas été si directement en cause, et si on ne m’avait, sous ce prétexte, fait lever à une de ces heures dont on ne voudrait même pas pour mourir… »
Paradoxe…
C’est en fait à partir de son départ de Paris que la notoriété va commencer à pointer son nez.
Il est devenu, à son insu, le chef le l’école parisienne des Fantaisistes à laquelle appartiennent Carco, Vérane, Pellerin, Derème… d’ailleurs mauvais terme, fantaisiste, pour définir ce qu’il écrit. On parle de lui. Pas très fort, mais on en parle. Le poète, pendant ce temps, met de l’ordre dans ses papiers, regroupe ses textes.
Tant de travail, docteur, pour découvrir enfin
Que l’Être se nourrit, et meurt de pourriture ?
Ah ! cesse, à tes fourneaux, d’avilir la nature :
Ce n’est que songe et fleurs dont nos âmes ont faim.
Un éditeur marseillais lui promet une publication, qui ne se fera pas.
Henri Martineau lui consacre le numéro entier du Divan de juillet août 1914. La machine est sur le point de se mettre en marche, quand, on l’a vu, la guerre éclate.
Les jeunes mariés, c’est l’expression consacrée, ne riez pas, vont se poser au cœur de Guéthary dans une maison dotée d’un vaste jardin, plutôt d’un parc. La guerre a pris fin en 1918, la France est victorieuse. Il se sent mieux, fume son opium dont il a retrouvé les sources, s’ennuie, va quotidiennement au café Madrid… et, poussé par Martineau, prépare l’édition de ses Contrerimes, c’est le titre finalement choisi.
Confiant, il envisage même un prochain retour à Paris vers le milieu du mois de septembre 1920.
Mais le lundi 6 de ce même mois, à midi, Paul Toulet, dit Paul-Jean, s’envole pour l’au-delà, victime d’une hémorragie cérébrale.
Les Contrerimes seront publiées l’année suivante par Henri Martineau… annonçant ainsi la future notoriété particulière du poète.
On trouvera, entre les pages du livre qu’il lisait, une feuille sur laquelle il venait d’écrire un brouillon de texte, avec ses possibles rajouts et corrections…
Ce n’est pas drôle de mourir 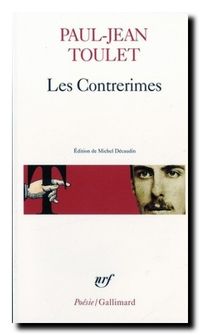
Et d’aimer tant de choses
La nuit bleue et les matins roses
Le verger plein de glaïeuls roses
(L’amour prompt)
Les fruits lents à mûrir.
Ni que tourne en fumée
Mainte chose jadis aimée
Tant de sources tarir
Voir tant d’amour tarir
O France, et vous Île de France,
Fleurs de pourpre, fruits d’or
L’été lorsque tout dort
Pas légers dans le corridor.
Le Gave où l’on allait nager
Enfants sous l’arche fraîche
Et le verger rose de pêches
Gave aux ondes trop fraîches
Au retour on cueillait des pêches
Enfance, cœur léger.
Bibliographie partielle
Ce recueil, très bien conçu et très bien présenté par Michel Décaudin, nous offre l’intégralité, ou la quasi-intégralité, de l’œuvre poétique. C’est-à-dire les Contrerimes, mais aussi les Chansons, les Dixains et les Coples. Le premier recueil à posséder, bien sûr.
-
Œuvres complètes, édition présentée et annotée par Bernard Delvaille © Bouquins, Robert Laffont, 1986 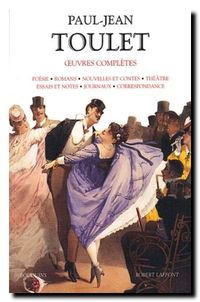
Frédéric Martinez a réussi le tour de force d’écrire une biographie de Paul-Jean Toulet qui joint l’exactitude à l’écriture poétique. Né en 1973, docteur ès lettres, déjà auteur d’un Maurice Denis, les couleurs du Ciel, il sait marier l’émotion et le rire… il a du talent, beaucoup, ce monsieur Frédéric Martinez !
Jean d’Ormesson a écrit ces deux tomes pour son plaisir. Il ne pensait pas qu’ils pourraient se vendre correctement. Et, surprise, la machine a fonctionné. Succès.
Il s’agit d’un choix en fonction de ses goûts. Cinq à dix pages, pas plus, par auteur. Poètes, historiens ou romanciers. Magnifique. Ce qu’il faut de culture, d’aisance, d’humour et d’intelligence pour pondre en quelques lignes chacun de ces portraits me laisse pantois. Vie, caractère, époque et œuvre, tout y est. Il ne le sait pas, Jean d’Ormesson, mais là, il a enfanté un ouvrage unique en son genre, un chef-d’œuvre, je dis bien un chef-d’œuvre.
Toulet occupe les pages 215 à 222. On conjugue le verbe se régaler. Que dire de plus ?
Internet
Contribution de Jean-Louis Guitard
Il y a des coïncidences qui se méritent. À l’heure où J.M.G. Le Clézio est l’invité de tous les plateaux culturels et littéraires pour présenter Le flot de la poésie continuera de couler, le livre qu’il consacre à la poésie chinoise de l’ère Tang, Guomei Chen publie aux éditions des Deux-Siciles, Si profonde est la forêt, une anthologie de la même poésie. La notoriété de l’un n’enlève rien à la qualité du travail de l’autre. Guomei Chen nous a accordé un entretien dans lequel elle nous explique l’histoire de son projet.